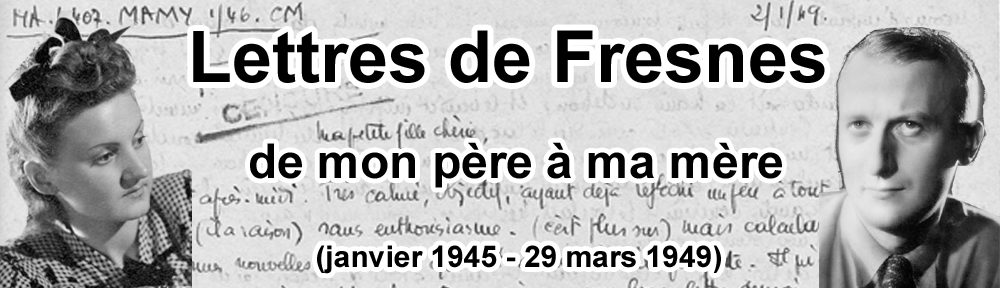Samedi 15 décembre 1945
Petite Jeannette si blonde et si chérie (parce que blonde et parce que Jeannette),
Je commence ma lettre un samedi. Veuille noter cette attention particulière. Est-il déjà permis de penser à Jeannette un samedi ? Les Juifs discutaient beaucoup avec Jésus pour savoir s’il était permis de guérir le jour du sabbat. Et cela fut résolu par l’affirmative, ce qui valut au fondateur du christianisme la joie d’être persécuté par ces coupeurs de cheveux en quatre. Me persécutera-t-on parce que j’ose écrire à Jeannette dès le samedi et le règlement interdit-il de penser à ceux dont le souvenir quotidien, la présence quotidienne, s’impose à vous sans rémission, autrement qu’au moment précis de leur écrire le jour dit ? Voici que nous sommes en plein domaine métaphysique à trancher superbement tel un nœud gordien dont on n’a cure. Les murs d’une prison n’ont jamais empêché les poètes de chanter, ni les hommes de crier leur amour de la vie, leur joie d’êtres libres, leur contentement de rouler des idées heureuses. Toute la méchanceté du monde n’altèrera pas la perfection, le bonheur du réel. C’est pourquoi nous piétinons d’un pied léger les scrupules, et les limites, et que nous osons penser à Jeannette un samedi. D’abord pour lui dire que sa dernière lettre était fort gentille et tendre et qu’il nous sembla lire à travers les lignes si espacées de multiples choses qui nous réjouirent. En particulier (Ô égoïsme) surtout ce qui concernait sa visite à Floriot. Est-ce illusion, mais il nous parut qu’elle remporta de sa visite une impression heureuse. Peut-être aussi les événements tournent-ils au gré de Jeannette puisqu’elle ne parle plus déjà que de quelques mois encore d’attente. Est-ce une indication précise ou un désir vague ? Je prends volontiers cela pour une indication. Qu’a donné la visite aux amis ? Y-a-t-il de ce côté de nouveaux ennuis ? Cela n’est guère possible —ou alors ce sont des nuages qui seront tôt dissipés.
Je pensais à toi chère —non seulement de toutes les façons que tu peux supposer— et qui ne sont pas pour te déplaire —car il n’apparaît pas que tu négliges les douceurs et les tendresses et le respect —et même l’irrespect— (entendons-nous bien, sans dépasser les limites de la bienséance). Disons que ce sont des attentions accordées à la vertu pour en éprouver la solidité et la transformer au plus haut point en tendresse généreuse, en abondance de bénédictions de toutes sortes, y compris celle de trouver un matin dans son potager un formidable garçon qui, pour être né dans un chou, m’a l’air déjà d’un fameux lapin. Surtout sache bien qu’il ne peut te donner un surcroît de travail, mais qu’il te force à épancher dans la vie un surcroît d’amour. C’est un bienfait des dieux ce bonhomme-là. Il fait vivre à ses trousses toute une maisonnée qui attendait le héros sur qui reporter son affection.
Pour aujourd’hui, je n’en dirai pas plus. Mais je vais néanmoins te demander un petit cadeau de nouvel an si possible. Il me faudrait pour moi, soit un énorme et volumineux carnet, soit le plus gros cahier (quadrillé fin) que tu puisses trouver, et si possible avec une pagination répertoriée (tu sais les lettres sur les côtés). C’est pour commencer une anthologie poétique personnelle qui durera ma vie entière, et bien au-delà. Donc, il me faut quelque chose d’énorme. Cela peut être du format des feuilles perforées que tu m’envoies, mais pas plus grand. Si tu pouvais trouver 200, 300, 500 pages… n’hésite pas. Il doit durer, et j’en fourrerai dedans. Je suis trop embêté à ne pas me rappeler des textes que je voudrais savoir par cœur pour ne pas commencer, dès maintenant, en mon tendre jeune âge, un document de cette valeur. Donc, veux-tu bien prendre ton bâton le plus noueux pour t’aider dans ta marche à travers les papeteries et me dégotter ce mouton à 5 pattes : le plus gros cahier en format quasi réduit que tu puisses trouver : 1000 pages si tu veux —le plus gros, gros, gros cahier— et tu auras droit au plus gros, gros, gros baiser. S’il n’y a pas de pagination, pas d’importance, nous en ferons une. L’important est que sous volume réduit, j’ai le plus de notes possible. Voilà. Sur ce, je te bise et te souhaite bonne nuit, bon dimanche, bonne chance, bon sourire et bonne patience, et te remercie d’avance de tout ce que tu me dis aujourd’hui et de tout ce que je sais que tu m’écriras demain.
Dimanche.
Je prendrai le ton fort sévère: Je n’ai pas reçu de nouvelles de Jeannette, ni hier, ni aujourd’hui. Voila pourquoi il pleut, et pourquoi le culte que nous devions avoir cet après-midi est reporté. De sorte que j’en suis réduit à noircir du vierge papier avec des pensées aimables, de l’arc en ciel sous un voile d’encre noire. Sur mon mur, des tas de photos d’actrices et d’acteurs qu’un prédécesseur a laissées là. Quels vieux souvenirs, mais combien j’ai peu envie de revoir le « milieu ». Le cinéma et le théâtre me font horreur. Tout y est si vide, laid, vaniteux, déplaisant. Je ne peux plus. Misanthropie ? Il faudra me guérir de cela à coups de concertos de violons. Dire que je n’ai jamais entendu Jeannette faire de la musique. Ce doit être très sérieux. Elle doit froncer le sourcil et pincer les lèvres, et puis la mesure ! Et puis le respect des classiques. Les grands dieux de chez Pleyel, les titans de chez Gaveau. Voilà bien que les concerts commencent à me manquer. Tout le mépris que j’ai pour le théâtre de pacotille de l’époque est compensé largement par le seul souvenir de Wagner ou de Berlioz. En sortant d’ici je travaillerai peut-être pour être chef d’orchestre. Pourquoi pas ! On arrive à tout âge. Trêve de plaisanteries et parlons de choses sérieuses: j’ai besoin d’un peu de buvard. Voilà le gros souci de la journée. Le mien est usé. Il y est déjà passé dessus un monde de pattes de mouches. Je m’excuse de te demander tant de choses, mais je suis sûr que cela ne t’est point trop désagréable de donner, ne fut-ce que par charité chrétienne, à plus forte raison par tendresse particulière —qui, entre-nous soit dit, chérie, ne saurait dépasser ni même atteindre l’amour de Dieu. Mais qu’y faire ? Nous sommes aimés que nous croyons pouvoir ajouter par nos efforts personnels à l’œuvre admirable qui existe déjà. Quelle audace ! Mieux vaut être humbles et savoir que nos amours ne sont que le modeste reflet de l’Universel Amour dont nous tentons de suivre les ordres. C’est pourquoi, confiant dans la suprême Bonté Divine, j’ose lui demander un buvard pour étancher mes vers, et la muse du poète saura bien trouver cet indispensable calmant à ce fougueux lyrisme. Sur ce, à demain. Il faut réserver la place pour tout ce que j’ai d’immense à dire dans cette superbe et prodigieuse journée de lundi (à propos, as-tu quelques punaises dans ton tiroir ? Mets-les dans une petite boîte en te disant qu’il est toujours utile de pouvoir épingler des photos sur un mur).
Lundi.
Je suis penché sur ma table depuis ce matin, à copier des textes métaphysiques, à méditer sur d’autres passages plus ou moins bibliques et, de temps à autre, je regarde le sourire d’une photo qui troue le mur avec ses yeux vifs et son étonnement amusé. Le temps est beau. Ma nouvelle cellule donne un peu plus sur la campagne. On voit des arbres à les toucher, des champs à croire qu’on s’y promène et des paysages lointains qui viennent affirmer qu’il existe encore une nature libre, des oiseaux, des bois, des ruisseaux, des coins de vie qui soient à l’abri de la méchanceté des hommes. Il en existe en tous cas un, c’est une certaine mentalité de poète que les crachats, les injures de la foule ne sauraient atteindre ni meurtrir. Le plus précieux de nous même est toujours sauf, de par Dieu, et plus on essayera de nous ravaler au dessous de la boue, plus il éclatera la vertu des transcendances.
Aucune nouvelle encore aujourd’hui. J’espère avoir du courrier ce soir ou demain, et tout à l’heure descendre pour le colis hebdomadaire dans quoi trouver les habituelles douceurs qui font tant éprouver la gentillesse dont une certaine dame du boulevard Diderot est abondamment pourvue. J’ai une nouvelle pièce en tête et, après des travaux divers et urgents qui vont encore m’occuper pendant quelques jours, je compte bien commencer à ouvrir un nouveau chantier. As-tu fini Gabriella ? Les dernières poésies te plaisent-elles ? Je crois qu’il y en a qui ont vraiment de la valeur. Mon sens critique n’est point si abruti que je ne sache plus distinguer entre un ours et un navet, et je sais que tout ce qui est issu récemment est rempli d’une certaine substance que je revendique comme étant peu vulgaire. De là à crier au chef d’œuvre, non ! Mais patiemment nous nous approchons d’une certaine moyenne honorable, et peut-être mieux si possible. Je te serais reconnaissant d’y travailler dès que tu pourras. Je pense encore avoir le temps d’écrire la pièce projetée, avant les solutions prévues par les circonstances (solutions que j’espère bonnes, il semble bien que ce soit la détente). Comment cela va-t-il dehors ? Les gens commencent-ils à comprendre qu’ils ont été joués par des bandits et des politiciens tarés ? Y-a-t-il un relèvement de la mentalité ? Est-on plus courageux pour travailler, se reformer, reprendre goût au travail collectif, aux œuvres communes, ou continue-t-on à se déchirer ? Pour nous qui vivons depuis des années (depuis 40 exactement) sous les injures et les coups, il y a beau temps que nous avons évolué. L’expérience fasciste nous a ouvert les yeux sur ce qu’il fallait faire et éviter et on sera surpris, le jour où on ouvrira les prisons, de trouver tant de bonne volonté à bien faire, à moins qu’on nous force à émigrer, toujours sous les mêmes hurlements. Ceux qui crient ne sont-ils pas enroués ?
J
PS. Je suis à la cellule 326. Pour le reste, rien de changé. Dis le à ma mère. Je viens de remonter des colis. C’est trop, trop gentil. Je crains que vous vous priviez toutes. Il ne faut pas que je sois pour vous une charge. Veuille ne me mettre que l’indispensable et pas de friandises coûteuses. Merci pour le méta. Ne l’oublie pas chaque fois. Demande de l’argent à ma mère.