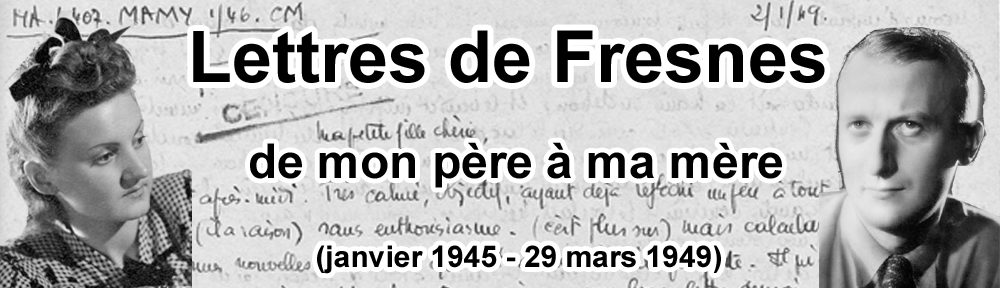Dimanche 31 août 1947
Ma petite fille chérie,
Je viens de recevoir ta lettre de jeudi, toute pleine de bonheur champêtre, de santé et de douces tendresses. Pendant que tu te promenais dans tes châteaux (avec moi, parait-il, et c’est vrai, j’étais sans doute présent. Il y a des moments, des heures, où je te vois vivre, où je suis le Frédéric pas à pas, où je nous sens courir tous trois, sans nous lasser jamais, à travers une campagne neuve), je promenais sur les murs de ma cellule un pinceau chargé de ciel pur. Non point que je cherche à la revêtir d’une quelconque pâte liquide, mais je travaille plutôt sur l’étroite prison de cette conscience humaine qui nous fait voir des prisons là où est la liberté, des hordes ennemies là où sont les chœurs célestes, des guerres et des famines devant les champs fleuris et les fruitiers chargés.
Il parait que tout va mal dehors. Tout va si bien là où nous sommes. En plein essor, en pleine joie, en pleine réalisation d’abondance intime. Nous construisons un monde qui apparaîtra demain comme le plus harmonieux et le mieux fait. Avec tant d’entraide, de sollicitude, de patience, d’énergie, chacun de nous a compris à quel point la solidarité est précieuse pour que le sang vif d’une société coule à flots dans des veines saines. On se chamaille, mais on se comprend. On s’asticote, mais on s’entend sur l’essentiel. Et nous semons un grain qui mourra bien pour mieux revivre.
Pour toi, tu as besoin d’une tendresse infinie. On te la donnera. On te la donne déjà. On te la donne toute entière. On ne te la ménage pas. On en a pour toi des réserves. Le capital en est inépuisable. On en prévoit pour tout le temps qui est visible et pour l’éternité invisible. On prend cette tendresse là où il faut pour qu’elle soit pure, et forte, et pénétrante, et présente, et solide. On la cherche du fond du cœur guéri. On te regarde avec des yeux clairs pleins d’âme, où le souffle de l’amour a pénétré comme un vent d’orage, plus léger. On a construit sur toi une vie pleine d’efforts. On te sent prête à marcher d’un pas sûr. On aime sa tête sur ton épaule, mais aussi ton bras sur le nôtre, puis ta voix, et ton silence, et ta joue, et ta main, et ta patience. On aime à te lire, et t’entendre, et penser que tu vis, sans plus parler, et goûter quand tu ris, et quand tu souris dans l’ombre, et quand on écoute ton cœur battre si fort qu’il troue la nuit comme une étoile jusqu’à s’arrêter sur la plus pure chaumière où gît l’Amour, dans les Noëls sacrés de nos confidences les plus hautes.
C’est Baudelaire qui adressait à une déesse noire des vers voluptueux, la couvrant d’ornements, de désirs et de violences. Je n’aurai pas de gestes pour toi, mais des élans, des tendresses si calmes, des prières si claires, que tu seras placée sans heurts au plus haut du ciel jusqu’à entendre la musique constante des anges de toutes les heures : ceux de la symphonie brûlante du midi de plein cuivres, ceux du crépuscule ardent à combattre la nuit, ceux de minuit qui rêvent, et dorment, et veillent, et maintiennent l’huile dans la lampe du sanctuaire, ceux du matin éclatant quand se défripent les songes et les buées qui rodent sur la montagne de nos plus hauts espoirs. Toute entière dans ma musique et dans ma poésie la plus inspirée. Toute entière dans la simplicité du cœur et dans la bonté du jour. Tout entière dans ma vie chargée d’évènements et justifiée jusqu’à n’être plus qu’une vitre blanche toute entière dans la lumière de Dieu. L’Esprit ne change point. Il t’a créée si parfaite qu’on ne saurait que t’admirer de par lui et je reconnais en toi tous les reflets de la vie que j’aime. Tu es bénie. Je suis le seul qui te le dise avec autant d’audace, et je maintiendrai sur tes yeux limpides la fenêtre grande ouverte pour qu’ils boivent tout l’infini et plus encore.
18 heures.
Voila que des camarades viennent de me quitter après discussion et souvenirs passionnés. Mon café chauffe. Le temps est beau. L’heure est douce. Ton image est sur le mur. Je n’ai même pas besoin de regarder cette photo au sourire que je bois depuis deux ans ½. Tu vis devant moi comme un ange de tous les jours.
21 heures.
Les nouvelles nous arrivent d’heure en heure. Nous savons. Nous présentons. Nous imaginons. Nous supposons. Nous devisons. Il y a 20 minutes : conversation des « gaffes [1] » les plus durs, les plus cocos de la maison. Tout à coup prévenants et dociles au point de nous laisser les cellules ouvertes jusqu’à une heure indue. Plusieurs songent à s’enfuir précipitamment à la campagne. D’autres parlent de dictature militaire imminente. Le mot de catastrophe est prononcé à tous instants. La situation leur apparait désespérée. À l’ambassade anglaise (tuyaux reçus d’ailleurs) on prévoit la chute du gouvernement pour ces jours prochains. Bref, tout semble s’éclaircir pour nous. La France va bientôt se trouver devant une telle révolution, un glissement à droite comparable à celui de 40. Il est vraisemblable de penser que l’expérience de la IVème République est terminée bientôt. Ne crions pas trop vite.
J’ai vu le secrét[aire] de Flo[riot] ce matin (je l’avais convoqué). Rien n’est prévu pour nous pour octobre. Le Parquet ne prévoit pas l’affaire avant au moins fin octobre, sans préciser. Je crois que ce sera infiniment mieux que cela. Mais j’ai demandé à tout hasard à Flo[riot] d’obtenir un supplétif d’information. Il se peut qu’on n’en ait pas besoin.
Je pense toujours tenir ma promesse pour Noël.
Sur ce, nous allons nous coucher sagement, et penser à des choses vivantes, c. à d. le calme, la tranquillité, la vie ardente et sereine, le bonheur, la joie, l’éternité, le souffle de l’amour puissant, les cheveux blonds de Jeannette entourant des yeux chargés de plaisir sain, la vie retrouvée et jamais perdue.
Sais-tu que j’ai l’impression d’être un naufragé qui aborde une côte. Qui va aborder. Mais il reste encore peu de mer à franchir. On arrive bientôt. Ce n’est point mirage. Je n’ai jamais douté. Maintenant je puis affronter n’importe quelle tempête de la vie.
Lundi 1er septembre.
Je me suis réveillé comme tu étais dans mes bras. Tu dormais si délicieusement avec tant de confiance enfantine que je n’ai point voulu interrompre ton voyage dans le ciel de ta fantaisie. Puis, tu as pris conscience de tout le flot de tendre émotion que je déversais sur toi, et tu m’as sauté au cou (nous ferons cela tous les matins pendant tout le temps que nous aurons à cheminer ensemble, c.à.d. toute la vie de ce rêve mortel qui sera traversé d’une telle lumière que nous verrons déjà au-delà de cette chair).
J’ai reçu le colis ce matin avec toutes les choses délicieuses que tu préparas depuis longtemps et que tu envoyas de la Creuse. Et je me suis déjà gorgé de toutes tes prévenances. Aujourd’hui je prends des dispositions pour que le jeudi 11 te soit réservé. Les nouvelles sont meilleures d’heure en heure. Je prends mes dispositions pour tenir toutes mes promesses. Dieu tient toujours toutes les siennes.
19h30.
J’ai laissé mes camarades discuter furieusement dans le vide et suis venu poser ma tête contre ta tempe. Voilà ce qui se passe. Tout est très bien. Tout est très beau. Tout est parfait. Tout est si merveilleux qu’on n’imagine rien de mieux. Il n’y a que toi et moi et l’infini partout. Et le silence. Et l’amour. Et la joie. Et la veine de ta tempe qui bat. Et tes cheveux où crépitent la lumière et les caresses de l’ange.
As-tu travaillé à tous les vieux travaux que tu as sans doute emportés ? Non ? Oh, bien tant mieux, tes vacances auront été des meilleures et nous les taperons ensemble dans peu de temps (tu vois comme j’ai confiance). Oui ? Alors tant mieux. Nous aurons plus de temps à nous pour rire, et marcher, et courir les bois, et manger l’air des vallées et des monts. De quel côté veux-tu que nous allions construire un édifice éternel ? Dans la Creuse ? Dans le Dauphiné ? Dans les gorges du Tarn ? En Vendée ? Il faut un coin perdu pour perdre tout souvenir du mal d’hier. Il s’est déjà dissipé tant le vent est fort, ce vent d’esprit qui déblaie les nuages comme un tourbillon de poésie fraîche.
Je n’ai pas trop travaillé pour toi depuis 2 mois. Mes travaux me sont plus personnels. Je me suis occupé surtout d’exégèse, travaux spirituels, organisation du mouvement religieux, toutes choses qui sont souvent plus utiles, mais qui ne capitalisent pas. Toutefois, mon esprit s’est mûri beaucoup. Je vois les choses avec tant de sérénité qu’il me semble être un autre homme depuis trois mois. Un travail fantastique s’est fait ici dans l’esprit de beaucoup. Plus de revanchisme, plus de violence, plus de craintes, finies les excitations stupides ; ces gens vivent maintenant dans le calme, le repos, l’action heureuse, ayant oublié leurs ennemis.
J’ai aussi beaucoup grossi. C’est très ennuyeux mais je crois que cela passera très vite. Ce que c’est que d’avoir bon moral, et peu se démener. Pourtant on bouge un peu plus qu’en cellule, mais le fait est là. On prend de l’embonpoint exagérément. Trop de féculents. Trop d’inactivité. Il me faut maintenant me jeter à corps perdu dans un gigantesque travail de construction où je dépenserai toute mon énergie (et il y en a). Je me sens plein de courage, d’une ténacité absolue. Et d’une jeunesse ! Il semble que la vie soit toute neuve à chaque pas.
Ma chérie, je t’embrasse comme il n’est pas possible. Tu as été si gentille, si dévouée pendant ces trois ans. Tu as témoigné tant de fidélité vraie. Tu t’es montrée une compagne si parfaite. Tu as tellement donné, et du plus précieux de toi-même que tout cela mérite reconnaissance, amour, affection, émerveillement, récompense d’autant plus grande qu’elle correspond à mon instinct secret et que j’ai découvert dans un vieux recoin où je n’imaginais guère que quelque chose fut libre encore tout un infini prêt à s’épandre. Laisse-moi prendre ton épaule dans ma main, tes yeux sous mon regard, et embrasser tout l’espace que tu as en toi comme un souffle qui veut ranimer la flamme toujours vivante. À nous deux nous ferons le voyage tranquilles et en toute sûreté. À te lire, à te voir, à t’entendre. À bientôt te serrer dans tous mes bras. Ils sont mille et mes baisers sont millions. Embrasse le Frédéric comme le soleil chauffe la terre, maternellement.
J.
[1] Gaffe : synonyme de maton, gardien de prison.