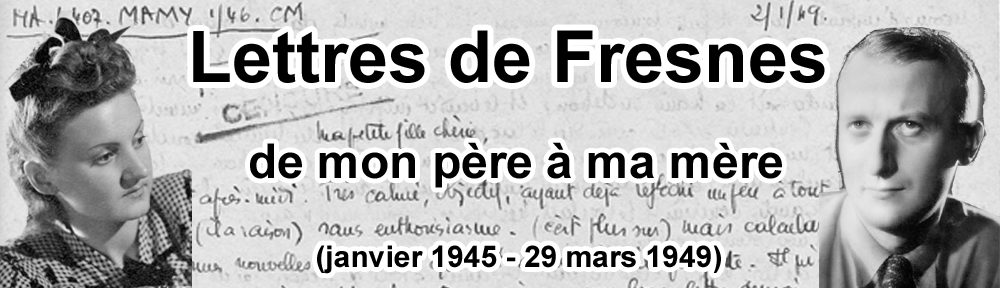Samedi 10 janvier 1948
Blonde chérie et petite fille toute menue,
Du lundi 5 tu m’envoies : « gros baisers, très tendrement ». Du 7 : « Je pense à toi beaucoup » (deux fois, au début et fin de lettre) avec un triple « gros b. ». Quel cœur labouré de passion ! Quel esprit remué de souvenirs ! Quel espoir pour demain (je ne dis même pas après-demain… car, symboliquement, les jours sont des années et il ne faut pas reculer notre date de libération). Et bien moi, je ne pense pas du tout à toi. Mais pas du tout, parce que quand on est enfermé dans une cellule à neuf barreaux et à porte verrouillée, il est beaucoup trop dangereux de penser à une tête aussi chiffonnée et à des yeux aussi brillants (tu étais fort gentille quand tu es arrivée l’autre jour dans l’ouverture de la porte, avec un bonjour qui coulait comme une source. Comment veux-tu que j’introduise dans une pièce aussi austère, peuplée de crucifix et d’images de puritains farouches une idée aussi poudrée, aussi mignonne, aussi simplement délicieuse ? Je suis obligé de te chasser par la fenêtre chaque fois que tu apparais féériquement avec des charmes qui troublent le moine, qui risquent de le troubler car ils ne le troublent point. Nous sommes, Dieu merci, accroché au roc de notre prudence, nous dormons sur un oreiller étoilé, certes, mais nous n’entendons que le vent du désert qui mugit ses mots sévères, ses ordres bibliques, et nous laissons courir au dehors, bien loin ces souffles féminins qui nous inciteraient à la mollesse. Nous sommes des ermites bien cuirassés, nous autres, et s’il apparait quelquefois dans la mémoire une image chère, elle est nimbée d’une auréole si pure que nous sommes bien assurés de ne point voir là un démon trop familier.
J’ai recueilli toute ta peine à l’annonce de la disparition du cousin [1] que tu aimais tant. Les morts ne le sont que pour nous car ce n’est point le néant qui nous attend mais un passage. Ils vivent dans de nouvelles conditions, ayant laissé derrière eux une pauvre enveloppe que nous pleurons, mais, beaucoup de peuples, très religieux et très affinés, ont compris qu’il fallait toujours, en toutes circonstances, se réjouir de ce que l’homme continue à travers toutes formes et qu’il marche d’un pas léger vers son véritable destin qui est de retrouver sa lumière toujours présente, en dehors de toute matière. Le corps, c’est la feuille de l’arbre qui sèche et tombe ou s’envole au vent. L’arbre reste, et si non celui-là, un autre, la famille de l’arbre, et quand toute végétation disparait d’une terre, une autre étoile s’allume qui fleurira au jour de sa tiédeur. Nous sommes toujours dans l’infini, et ne devons point regarder le rêve de la terre. Il est bon que tu aies souffert à cause d’une mort. Je t’embrasse sur toute ta peine, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de peine.
Les condamnations qui avaient faibli depuis quelque temps redeviennent féroces. En trois jours, une condamnation à mort, pour un de nos camarades qui espérait valablement cinq ans, et 15 ans pour un autre, qui aurait dû s’en tirer à deux ans. Un troisième est condamné à perpétuité, qui aurait pu être classé. Les fêtes ont mal disposé les juges. On s’attendrit un peu vers Noël [2], et on reprend en janvier ses balances rouges. D’un autre côté on parle toujours beaucoup d’amnistie. Louis Rollin a déposé un projet. De plus la situation internationale se tend à l’extrême. Il faut remonter une dure pente. Qui sait si l’on pourra.
J’ai relu cette semaine de bons vieux documents : La France du Directoire [3] de Madelin, les écrits politiques de Chateaubriand, les mémoires du baron de Toustain, l’histoire de la Convention de Gallois, tous probants, décisifs, affirmant que la Révolution Française, qu’on prétend si génératrice de bienfaits, a été, à partir du moment où elle a cédé aux émeutiers (et elle ne pouvait pas ne pas céder) une catastrophe. Il ne faut jamais accepter la dictature de la canaille. Il ne faut jamais s’allier avec elle, la subir, la tolérer, la laisser libre. Il ne faut jamais se départir de sa vigilance et relâcher son éternité sur les passions populaires. Il faut toujours protéger le peuple mal instruit contre lui-même, contre les meneurs du désordre, les excitateurs intempérants. Je deviens de plus en plus farouchement contre-révolutionnaire si l’on accorde au mot révolution un sens de glissement vers les excès des primaires. À force de gronder, la bête devient furieuse, enragée et un jour il faut l’abattre. Et les pires conseilleurs auront été ceux qui, par timidité ou philanthropie démente, auront obstinément donné des conseils de modération, alors qu’il fallait, dans le combat, un surcroit de vigueur. Est-on modéré pour éteindre un incendie ? Devant tel ou tel fléau, il ne faut que vaincre à tout prix !
Voilà pour aujourd’hui de bien grandes phrases. J’ai changé la place de ma table, qui trône au milieu de la cellule comme un bureau, et me sens tout disposé à écrire un volume entier. Mais il nous faut garder de la place pour toute la tendresse de demain. C’est pourquoi, quittant la plume, je t’ôte les boucles d’oreilles pour t’embrasser sur l’oreille et te dire tout bas les mots qui sont comme une compresse fraîche sur la tempe, puis, comme un vent brûlant, et qui courent si vite qu’on ne peut plus respirer., à les suivre dans tout le ciel. Bonsoir.
Dimanche.
Voici que je m’aperçois que j’ai commencé ma lettre un samedi soir. J’ai pensé à toi un jour plus tôt !!! Je dois te dire que j’y pense un peu plus souvent encore et qu’il passe quelquefois dans le ciel une certaine robe grise, un certain corsage à nœud papillon, un certain chapeau bizarrement découpé. Un vent de tiédeur ramène sur l’onde calme du souvenir des baisers étouffés par la tendresse et j’ai dans l’oreille des bruits de cœur palpitant. Tout cela pour songer à un couloir rempli de livres, à un feu rougeoyant de radiateur électrique, à des reflets de vieil or sur des bibelots chinois.
Ce soir ma cellule est bien peignée, tout en ordre. La branche de gui a grand air ancestral contre le mur, au dessus des marguerites d’il y a un mois qui tiennent toujours et s’ouvrent sans cesse, baignées quotidiennement d’une eau fraîche, comme notre flot permanent de poésie. Sur un papier d’emballage, fort propre ma foi, et c’est rare, les œillets et les tulipes, très avancées, à la limite, se dissimulent sous les branches exquises d’un feuillage vernissé. Au-dessus, la galerie de portraits des huguenots piqués sur un vieux papier pourri avec des punaises rouillées. Plus loin, la cuisine, c’est-à-dire une étagère branlante qui supporte mon fourneau à méta. À propos, absolument à bout de souffle le fourneau. Il s’en va en lambeaux. Si tu peux retrouver cette boîte de tôle qui sert à brûler pastilles et tablettes tu rendras un sacré service au prisonnier. Dans le coin, mangé d’humidité verte et pourri de salpêtre, ce qui est à la fois notre évier, notre ustensile hygiénique, notre lavabo, notre salle de bain, et notre défi à la dictature prolétaire, ce que tout Fresnes a nommé d’un nom admirable : le Staline, et qui est avec son robinet coudé, notre utile et dévoué serviteur.
La porte en face a bon air honnête avec son œilleton indiscret qui plonge toujours sur l’occupant. On prend l’habitude d’être surveillé. Quelle discipline ! J’hésite maintenant à monologuer. Puis l’autre pan de mur. Les étagères où j’entasse mes quelques provisions et assiettes. C’est le coin de la ménagère avec les balais, chiffons et cartons à ordures. Le lit, rude ferraille avec paillasse dure, drapé artistiquement d’une couverture raccommodée qui enveloppera tout à l’heure le bon sac de couchage moutonneux dans quoi je vais enfermer mes espoirs –que dis-je- ma certitude. Au dessus, un carton vert contenant une trentaine de livres, toute la bibliothèque protestante. Et sur le piton scellé dans le mur à quoi vient s’accrocher le lit pliant, deux branches de houx entrelacées.
Quatrième mur : la fenêtre qui ouvre sur des toits par-dessus lesquels on voit des arbres. Nous avons ainsi de quoi vivre. Puisque le Royaume de Dieu est « au-dedans de nous » que nous importe le décor, luxe ou misère, il ne s’interposer pas entre notre soleil et nous qui sommes la lumière et tout l’esprit se rit des tragédies humaines. Bonsoir. Tu es une fée.
Lundi.
Je dois te gronder. Ou bien me gronder d’abord. Je ne veux pas que tu fasses des dépenses aussi exagérées pour des livres que je demande, non à toi, mais au camarade qui peut le faire. Je ne te dirai plus rien. Tu fais trop. Je t’embrasse triplement mais je suis furieux contre moi. Alors je te réembrasse pour me calmer. Tu es trop gentille. Je ne peux pas dire à quel point tu me combles et tu me touches. Je ne te le dis pas. Tes fleurs sont ravissantes.
Colis parfait. Avis : pas de bougies ni d’allumettes pendant une semaine. Ai des réserves. Penser au riz. J’engraisse encore. Comment s’arrêter ? Il faut absolument de l’exercice. Vivement qu’on sorte.
Comme je suis encore furieux, je t’embrasse une quatrième fois, une cinquième fois. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit !
J.
[1] Il s’agit de Camille Boniface, fils d’Émile Boniface, frère de Marie Boniface, mère de « Jeannette ». Pendant la guerre de 14, alors qu’Émile et son époux Georges étaient au front, Marie a élevé le cousin Camille avec ses deux filles, Georgette et Jeanne, qui considéraient leur cousin germain comme un frère. À la Libération, Camille est parti en Indochine où il a monté une petite entreprise de transport avec quelques camions. On l’a retrouvé, fin 1947, assassiné par ses employés ou ses associés, nul ne le sait. (note de FGR)
[2] Imagine-t-il que 11 mois plus tard, ce sera lui qui sera condamné à mort justement le 24 décembre 1948 ? (note de FGR)
[3] La France du Directoire (1922) de Louis Madelin (1871-1956), historien, député et membre de l’Académie Française (note de FGR)