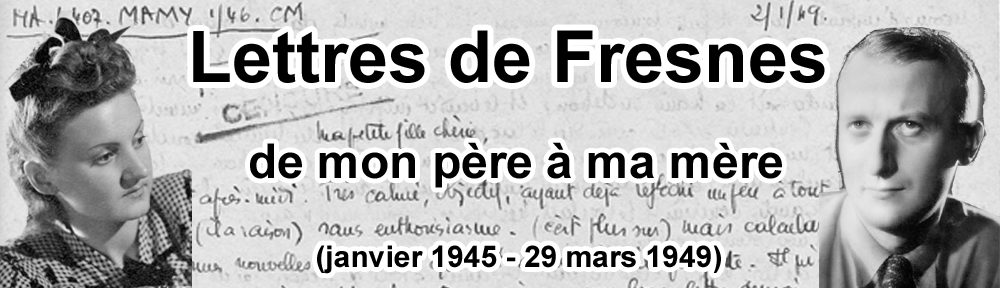Dimanche 18 avril 1948
Ma chérie,
Ainsi nous avons eu notre première scène de ménage dans la cage aux moineaux ! Voilà qui promet ! Tu étais très gentille en colère pour si peu de choses (on se met toujours en boule pour rien. Le monde stupide où nous vivons a commencé avec la révolte des anges). Je te classais jusqu’à présent parmi mes anges. L’image d’hier est à moitié démon. Heureusement que la fin de la visite fut plus rassurante. Sourires. Moues. Pardons. Gentillesses. Tu redevins sucrée. Mais la petite personne acide se démenait encore dans ma tête. Il y a un gros travail à faire pour que nous devenions parfaite. Je crois qu’il faudra de la patience. Et quelle humilité. Tu as de la chance que je sois à jamais blindé contre ce genre de nervosité toute féminine. Les jeux jaloux me laissent froid et tout plein de compassion tendre. On dirait qu’il faut défendre au chat de griffer, calmer le gros chien méchant, la petite panthère agacée. Le petit animal se couche, devient gracieux sous le regard de son maître, se pelotonne et recommence ses coquetteries.
Mais si je te considère non point comme un animal d’appartement mais comme une fille à qui on se confie, sur quoi on se repose, alors je serai net. Défense, pour notre commun repos, de troubler l’eau du lac. On ne voit plus le ciel qui se reflète dedans. Nous ne devons jamais agiter des spectres de désaccord. Au même diapason mamzelle. Et jouons en mesure. Une. Deux. Et suivre la baguette du chef d’orchestre. Et ne pas jeter son violon par terre. Et regarder la musique. Et y prendre plaisir… Et chanter la mélodie… Et comprendre l’émotion de l’auteur… Et la traduire…
J’ai déjà dévoré deux des bouquins que tu m’as apportés. Les romans ne m’intéressent pas. Par principe. Remercie toutefois Phil. Donne-lui les amitiés de Creyssel et Marion[1]. Creyssel est ravi du Cocteau. Moi aussi, un peu moins, mais beaucoup quand même. C’est une pensée rare. Très mondaine. Ce en quoi ce léger est lourd. Très matérielle en ce sens qu’il cherche le succès, l’éblouissement passager, le fugace, qu’il met la poésie dans l’instant, dans l’impondérable qui s’enfuit, l’inaccessible inexprimable qu’on décrit par symboles précieux. Je le trouve fragile comme une porcelaine. Il y en a de grands prix. Il durera plus que les autres. C’est-à-dire deux siècles de plus. On est si vite objet de musée.
Depuis quelques jours j’ai le sentiment de n’être plus dans la vie. C’est-à-dire dans la mort. La vie était pour nous autres, immatérialistes, l’esprit transcendant où la chair n’impose plus les limites des sens. On s’élance non point dans le vide, mais dans le concret d’un amour chaud, d’un esprit plein de substance absolue, solide. On éprouve la satisfaction, la réalité, le plein du contentement le plus rare. Dieu. Ceci nous vient en prison comme devant le poteau d’exécution, les crachats de la foule, ou le coin du feu tranquille, l’abandon des amis, de la femme aimée, ou bien la vie qu’on ait le goût de refuser ce qui n’est pas, l’insubstantiel, le non créé.
Voici le 4ème printemps qui s’avance. Les barreaux sont toujours aussi peu réels à nous qui sentons le prix de la vie au-delà des mortels. Je crois que nos adversaires, nos bourreaux, sont infiniment malheureux, le poids de la peur, le poids de la haine, le poids des curées d’hier, la hantise du lendemain. Que d’épouvantes. Ce soir le ciel est noir comme un drap tiède. Du velours mat. On se heurte ainsi à l’ignorance de l’œil qui ne voit pas les étoiles pointer à travers la brume. Il nous faudrait les mers du Sud. Moins d’hommes respirent là-bas. C’est pourquoi l’esprit plus clair voit les astres grossir, apparaître comme escarboucles sur grand fond gris. Et l’on devine déjà tout le monde extraordinaire des élus de Dieu qui peuple l’Empyrée. (A propos, où en est Gabriella et Envie de rire ?). Bonsoir. Mieux que cela. Pas sèchement. Bonsoir. Bonsoir. Plus profond. Bonsoir chérie. Bonsoir ma petite fille. Bonsoir mes cheveux châtains. Bonsoir le Frédéric. Bonsoir la maman du Frédéric. Bonsoir mes yeux tendres. Tu as rêvé… Non, tu n’as pas rêvé… Tout est très bien… Il n’y a pas de nuages sur la lune. « Toujours de miel ». Voilà la devise de chevalerie. « Toujours de ciel ». Dors, la vie est douce. Il suffit d’une épaule sainte, solide, sincère… l’oreiller d’or.
Lundi.
J’ai reçu ta lettre. Comme j’ai déjà oublié toute la vision de colère de la cage dorée, inutile d’en parler. Ta photo est bien floue, et les personnages lointains. Je crois que le viseur de ton appareil doit être déréglé pour toujours couper les pieds des personnages ou des objets. A vérifier.
 Les deux photos de Frédéric qui me plaisent sont
Les deux photos de Frédéric qui me plaisent sont
- celle sur le fond du palais du Luxembourg
- celle sur le fond du Jardin des Plantes où il ne sourit pas d’une grimace niaise mais où il a l’air naturel.
 Avis. Ne jamais faire montrer les dents à un enfant. Il ne sait pas sourire. Il faut déjà être vedette de cinéma pour savoir. La photo contre la gare de Lyon est mauvaise parce que vraiment trop conventionnelle. On sent qu’on a dit au gosse : Ris ! Et le malheureux plisse ses joues pour avoir l’air. Très gêné. Très gauche. Laisse le libre de montrer sa tête franche.
Avis. Ne jamais faire montrer les dents à un enfant. Il ne sait pas sourire. Il faut déjà être vedette de cinéma pour savoir. La photo contre la gare de Lyon est mauvaise parce que vraiment trop conventionnelle. On sent qu’on a dit au gosse : Ris ! Et le malheureux plisse ses joues pour avoir l’air. Très gêné. Très gauche. Laisse le libre de montrer sa tête franche.
Qu’est-ce que c’est que cette manière de se dénigrer en prétendant qu’on est laide ! Ce qui est laid c’est l’opinion qu’on a de son manque de plénitude. Il ne faut jamais s’enorgueillir, mais jamais se diminuer.
Merci pour le colis. Toujours parfait.
Les évènements tournent de plus en plus vite. Bientôt on ne pourra plus les suivre.
J’ai écrit à Floriot pour toutes sortes de choses. Ai vu Demery dimanche. Elle m’a fait comprendre qu’officiellement F. ne peut plus être mon défenseur. Pourtant… Est-ce que je devrais chercher une nouvelle somme d’argent pour payer le nouveau ? Qu’en penses-tu ? Cela me sera difficile. Il me semble que F. peut tout arranger. Je sais bien qu’il a été des plus modérés et merveilleux quant à l’efficience. Mais je ne pourrais jamais que le payer de promesses si quelquefois il estime devoir exiger un supplément. Au bout de trois ans ½ le prisonnier n’est pas riche. Je crois qu’il faudra que nous en bavardions. S’il ne veut pas plaider l’affaire, il pourra peut-être s’arranger avec son confrère. Moi je préférerai que l’affaire ne se plaide jamais. Et il faut croire que ce sera la solution. Il y a des protections divines qui se réalisent. Il vaudra mieux vivre à l’abri de toute guerre, de toute violence. Je deviens plus doux de jour en jour. Il me semble que je ne pourrai jamais revivre ce que j’ai vécu, refaire ce que j’ai fait. Non point que je désavoue, mais c’est autre chose. On devient prudent, et désireux d’apaisement. Je dirai même plus, le monde actuel se présente sous un jour si brutal qu’on se refuse à accepter cette vision sauvage. Nous avons mieux à faire qu’à pleurer sur lui, qu’à le souffrir, ou qu’à l’encourager dans son déchaînement. Il faut vivre haut, refuser pour soi ou pour les autres toute erreur, toute laideur, toute petitesse. Quand je revois certaines actions d’hier, j’ai le sentiment que nous aurions pu être plus calmes dans la tempête.
- Veux-tu bien me mettre une bougie, et demander à ma mère d’augmenter la dose d’ersatz café (sinon de café pur, mais j’aime presque autant l’ersatz). N’oublie pas un citron. Aussi une petite boîte de vanillette.
- Pour le prochain colis, procure-toi chez le cordonnier une plaque fde caoutchouc durci pour chaussures. Ça se vend parait-il partout. Un de mes camarades qui fabrique des sortes de pantoufles va me tailler là dedans une paire de semelle. Il parait que cela vaut une centaine de francs. Ne pas oublier. C’est urgent. Je te rendrai bientôt les chaussons de mouton qui sont assez tourmentés de forme.
Voilà que la nuit devient si douce qu’on se prend à rêver. Bien plus, à contempler un royaume infiniment plus doux et grand que celui des hommes. On se réveille. Passer du cauchemar à la vie. Voir enfin le démon du remords comme celui de la violence. Tu vois comme il faut croire à la vie belle, repousser tout ce qui n’est pas le parfait. Nous avons tous eu nos moments de colère. Parce que nous croyons à la réalité du mal. Et celui-ci n’existait pas. C’était le piège. Nous y sommes tombés. Il faut pour se relever admettre qu’il était le mirage, l’écueil. Et sourire à nouveau. Mes gros baisers. On t’embrasse encore, et encore.
J.
[1] Paul Marion, journaliste, militant communiste devenu l’un des fondateurs du Parti populaire français (PPF), membre du gouvernement de Vichy. En 1944, il devient secrétaire d’État auprès du maréchal Pétain, qu’il suit à Sigmaringen. Condamné à dix ans de prison le 14 décembre 1948, il est gracié en 1953 pour des raisons médicales, i