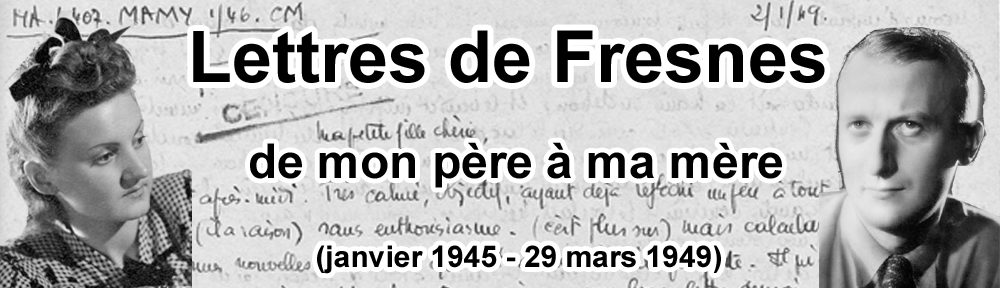Dimanche 29 août 1948
Ma chérie,
J’ai reçu ta lettre du 27 hier soir déjà et je connais maintenant tout le village, l’église, les monuments, les épiciers, la vache rousse et le chien têtu, sans oublier les figures fermées des paysannes qui refusent le lait pour mordre mieux dans la bourse du beau monde. Il le sait bien le maquignon qu’on dépend de lui pour l’estomac et son fiel s’acharne sur les papillons des villes. Complexe d’infériorité des ruraux. Hier, il nous détestait le château. Aujourd’hui, c’est l’homme des cités, le nouveau noble, celui qui a lu tous les livres. Nous marchons sur des tapis de serpents. J’ai accroché sur mon mur la photo d’un croquant prise au hasard dans un résidu de magazine pour m’habituer à regarder le problème en face. Quel rapport ai-je avec ce rustre à faux col, qu’un semblable état civil national à quoi je me refuse ? On devrait diviser le monde par catégories. Tous les barmans ensemble, toutes les filles aux yeux bleus, toutes les sentimentales et tous les moines. Je tourne de plus en plus la tête vers le couvent ou l’île déserte. C’est tout comme l’Océanie : couvent confortable, noix de coco, bananes, huîtres perlières et des ciels de toutes les couleurs, comme les poissons. Et l’ukulélé ! Cela ne nous empêchera pas de faire des scénarios second empire avec crinolines, calèches, chasses à courre et valses viennoises. Tu me donnes des idées. Voilà que mon moineau se dissèque devant mon nez et me révèle sa faim. Ainsi tu veux tout ce rêve bourgeois et militaire : dolmans, toupets, capelines et boucles à torsades. Facile. Nous allons exhumer nos arrières grand-mères. Elles étaient si braves filles. Prêtes à tous les cotillons et à copier le Journal des Demoiselles [1].
Ce soir je suis à mi-chemin entre la terre et le ciel. Un vague souci d’échapper à l’ambiance abominable des cimes d’en bas. Une échappée vers le certitude, vers une envolée plus sereine. Il semble que chaque pas brise en nous une paresse terrible, dégrippe tout un mécanisme rouillé. On conçoit tout le bien qu’il faut faire, on envisage d’être pur, mais quand il faut lever le petit doigt, quelle lourdeur. Nous remettons l’effort au lendemain. Or, Dieu exige d’être obéi. Et nous ne recevons le prix qu’au bout de la course.
Ainsi Dieu exige que je t’embrasse avec tendresse beaucoup plus infinie et pure qu’auparavant et que je découvre en toi toute la bonté, et que j’exalte toute ta patience, et que je remercie toute ton humble fidélité. Je te donne toute ma joie. Celle d’être. Celle de devenir. Celle de comprendre. Celle d’attendre. Toute la plénitude. Nous sommes dans l’été de la certitude.
Tu vois les évènements de cette semaine. Il se peut que d’ici très peu de temps il y ait de grands changements. L’échec de l’équipe au pouvoir est si flagrant qu’on ne saurait plus longtemps lui accorder crédit. Ils sont vraiment à bout de souffle. Et l’injustice qui pèse sur nous depuis quatre ans va cesser en même temps que leur tyrannie. L’expérience aura coûté beaucoup de morts et de sévices. Et surtout créé un gouffre entre les Français. Quel immense amour ne faut-il pas pour combler cet abîme ! Qui peut prétendre à la réconciliation ? Je crois que pour nous l’existence sera plus difficile encore dehors car ici nous ne nous heurtons qu’à des murs. Là-bas c’est plus grave. C’est l’incompréhension, la mauvaise volonté, la haine. Le tout bâti sur la honte de l’échec. On m’a cité des arguments invraisemblables de stupidité. On se demande comment des hommes pourtant cultivés en apparence peuvent être aussi bornés. Je vois déjà d’après des conversations que j’ai eues avec un brave pasteur démocrate qui a une sainte horreur des régimes autoritaires à quel point la naïveté peut entraîner certains bourgeois sur la pente de la tolérance envers Moscou. Ils pleurent aujourd’hui, mais sans se repentir. A force d’accorder la liberté à toutes les puissances du mal on met le feu à la terre entière.
Je suis plongé dans un bouquin de Blasco Ibanez [2], son voyage autour du monde. Passionnant. Il ne me donne pas envie d’aller dans l’Inde. Trop de serpents. Qu’on ne tue pas. Défense de toucher à un animal parce que vivant. Alors, vivent les poux, les punaises, les moustiques, les tigres, les najas et les cobras. Résultat : 35.000 morts par an, mordus par ces saletés. Moi je trouve que ce n’est pas beaucoup. Les guerres occidentales font plus de ravages. Et la haine de villages donc : le plus beau serpent.
Voilà que je vais abîmer tes vacances avec des soupçons de méfiance contre cette belle campagne bourguignonnes où sans aucun doute la médisance n’a jamais pénétré. Mais oui, le monde est parfait. La preuve, c’est qu’il a fallu nous enfermer tellement nous étions méchants. Depuis, dehors, on ne rencontre plus que des saints.
Bonsoir ma petite fille. Tu es adorable. J’attends tes photos, tes baisers, tes lettres, tes fleurs séchées, ou fraîches, tes promesses, et tout toi.
Lundi.
Tout Fresnes se réjouit de l’approche de la détente… ou du pire. Mais les esprits sont si faussés que chacun ne voit plus que son intérêt. Nous supportons. D’heure en heure les bobards courent. Et l’on tire des plans. Fin de régime. Fin de pays. Voilà le thème. A la suite de quoi tout le monde lorgne, qui l’Amérique du Sud, qui l’Océanie.
Ce n’est pas pour demain… mais les jours vont vite. Le louis d’or est monté samedi de 4.550 à 5.000 d’un coup. Aujourd’hui on ne sait pas. Demain… on sait moins encore ; j’ai pour moi quelque chose qui m’est beaucoup plus précieux que tout l’or du monde. C’est qu’à la faveur de l’épreuve j’ai trouvé une tendresse sûre. Tes yeux brillent mieux que des richesses factices et je regarde ta photo, pour fermer ensuite les yeux.
Nous allons avoir beaucoup de travail en sortant. Les affaires, les scénarios, Catherine. Tu y penses à celle-là ?
Belles images.
Je t’aime parce que tu es toute simple. Surtout ne complique rien. Sinon avec moi qui suis un labyrinthe à moi tout seul on risquerait de s’embrouiller. Mais tu es mon fil d’Ariane. Et il n’y a pas de Minotaure.
J’ai un besoin fou de musique. Et de peinture.
Pour l’instant j’explore un dictionnaire théologique. 5.000 pages. On fait ce qu’on peut. Et je relis Shakespeare dans la mauvaise traduction de Guizot. Aurais-je le temps d’écrire une nouvelle pièce ? J’ai un sujet pharamineux. Le plan est fait. Reste la paresse à vaincre. Et l’inertie. Et la fatigue. Et la tentation de distractions.
Mes moineaux sont comblés. Une grande assiette de pain mouillé. Ils se gavent. Surtout un jeune qui sort du nid et mange trois fois son poids. J’aime tous les moineaux.
Tu fais très bien de ne pas aller au cinéma. Spectacle vulgaire. Le plus beau film est celui que le public ne verra jamais et qu’on tourne secrètement, loin du monde, dans le silence, sur un paysage ignoré d’inégalable beauté.
Voilà que je viens de tonitruer pendant vingt minutes contre la bêtise des films, en particulier un certain Dédé la musique qu’on m’obligea à produire et qui m’a rapporté beaucoup d’argent mais peu de satisfaction véritable. Ceci à propos des trois titres que tu me donnes des navets de ton village. Il faut vite, vite, vite quitter tout ça. Partir, partir… Trouver le coin où s’établir solidement pour travailler honnêtement, et vivre sans souci de la foule, sans être empoisonné par une bureaucratie de parasites.
Maintenant que je me suis bien fâché contre tout le mal de la terre, me restera-t-il assez de place pour dire tout le bien que je pense de toi ? Et de nous ? Tu as raison, je ne suis pas si méchant que j’ai pris plaisir à te décrire. Il y a des jours où j’arrive même à être presque bon. Avec un peu de patience, quelques années de douceur, mais tu m’aideras ? Nous arriverons à guérir cette vieille méfiance qui nous fait douter de tous les amours. Sauf du tien, bien sûr. Il est bâti sur un roc qui ne saurait être ébranlé. Non pas vieille habitude, mais révélation. Je t’embrasse mille fois.
J.
[1] Le Journal des Demoiselles est un titre de presse français, publié à Paris de 1833 à 1922.
[2] Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) est un écrivain, journaliste et homme politique espagnol. Il est considéré comme l’un des plus grands romanciers de langue espagnole (Arènes sanglantes paru en 1908). Anticlérical et républicain, il mena une vie agitée et fut à l’origine d’un mouvement politique auquel il donna son nom, le blasquisme ; il fonda également le journal El Pueblo en 1894 pour diffuser ses idées. Il est notamment l’auteur de Voyage d’un romancier autour du monde (1925).