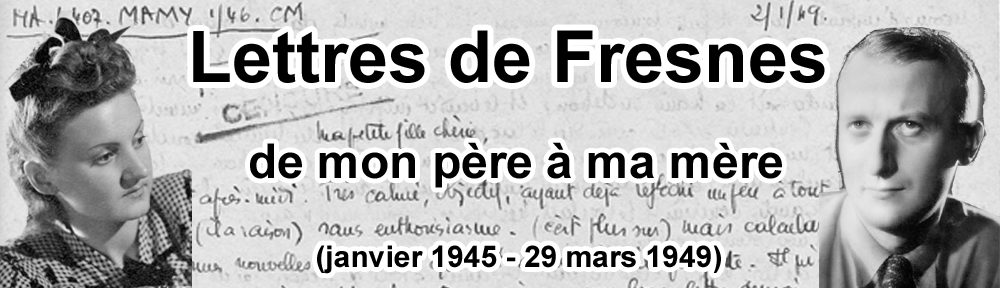Lundi 8 novembre 1948
Ma petite fille chérie,
Voici aujourd’hui une date bien mémorable : les élections au conseil de la République, écroulement de l’empire chinois (qui pour l’historien est un évènement comparable à la chute de la Rome Antique ou à celui de l’Empire d’Alexandre, mais pour qui sans doute le public occidental n’a pas d’yeux qui puisse voir, car il ne semble pas qu’on s’émeuve ici des conséquences fantastiques de l’évènement, bien plus considérable que les deux dernières guerres d’Europe). Une troisième raison de retenir cette date est que depuis hier soir j’ai déménagé deux fois. Après une courte étape au 4ème étage, je suis redescendu au 3ème. Motif ? Mystère. Les décisions de l’administration ne sont pas discutables. Je suis donc dans l’état fourbu de quelqu’un qui a lavé sa cellule en entier y compris le plafond, qui, depuis sept heures ce matin, s’acharne à trouver une place pour chaque objet et qui rêve d’une salle de bain (Ah ! que la mienne me manque. C’est la seule chose qui me manque. Y compris toi, bien sûr, mais tu ne me manque pas. Je t’ai beaucoup plus profondément encore qu’avant, lente exploration de quatre années de tendresses. A te concevoir, t’étudier, lire entre les lignes de tes lettres, qu’on finit tout de même par avoir à force d’insister. Et surtout savoir ce que contient le cœur immense de cette personne qui n’a rien à dire – non pas parce qu’elle a tout dit – mais peut-être parce qu’elle ne pense pas à le dire, ou même qu’elle ne pense pas à le penser.
Voilà qu’on vient de m’éteindre. Je compose donc à la bougie, si rare, les coupures d’électricité nous atteignent particulièrement. Dès 7 heures du soir, nous sommes dans le noir jusqu’au lendemain matin 7 heures. Pas drôle de dormir, ou de ne pas dormir, à penser sans pouvoir écrire. Il est vrai que j’ai pris mon parti de me lever tôt. Je crois que demain matin je serai un peu courbatu, d’autant plus que ma nouvelle paillasse est fort dure. Comment peut-on coucher sur des ressorts ?!! Sur un matelas de laine ?!! Je ne conçois plus rien de la vie douce. Quel autre monde ! Vous, les mondains, les gens libres !! Quelle drôle de chose !
Enfin une plume qui écrive à peu près à ma guise. Je sens que je vais faire toutes les maisons de Paris pour trouver celle qui convient. Il y a certainement beaucoup de modèles que je n’ai pas essayés.
Alors, bien entendu, tu vas trouver le monsieur qui doit s’occuper de la chose que tu auras mercredi. Tu ouvriras l’exemplaire et tu ne manqueras pas de trouver vers la fin l’enveloppe à lui destinée. Tu auras pour lui les plus douces paroles et les plus chauds remerciements. Tu verras, il est très laid, mais tout à fait charmant. Tu lui diras que tu ne comprends rien à tout ça, mais qu’il y a peut-être des fous que cela peut intéresser, des gens qui vivent dans un rêve de littérature étrange, des gens qu’on ne rencontre pas toujours dans le métro, qui sont amoureux des quais, des squares, des statues et des vastes espaces, et qui n’ont pour la ville qu’une sorte de prudente méfiance, parce qu’ils savent qu’elle est explosive comme pas une. Sacrée société ! En aura-t-elle eu des lubies !!
Je crois que les évènements en cours sont excellents pour nous. C’est-à-dire qu’on en reparlera dans trois mille ans. Mais nous avons déjà dépassé le sujet. Est-ce que tu crois à la vie éternelle ? Comment la conçois-tu ? Est-ce que tu as réfléchi à la vanité des choses terrestres ? Est-ce que tu sais que l’œuvre des poètes dure beaucoup plus que celle des rois ? Et même que celle des architectes ? Homère, Orphée sont toujours vivants. Et Virgile n’a pas cessé d’être l’inspirateur de milliers de peuples. Est-ce que tu sais que l’art est le seul langage qui soit digne du nom d’homme. Quand tu m’as parlé l’autre jour d’un film « commercial » j’ai frémi comme si le spectre du pauvre artisan mercenaire que j’étais hier surgissait devant le grillage. Je ne veux plus penser au public d’aujourd’hui. J’écris pour dans deux mille ans. Et si je compose un scénario sur les crinolines et les calèches ce sera pour les générations de l’an trois mille. Elles seules m’intéressent parce qu’elles auront à peine assimilé la culture antique et un petit peu du classicisme et du romantisme. Combien d’écoles littéraires leur auront passé sur le ventre d’ici là ? Pour qu’il y ait un nouvel art, faut-il dépasser tout. Oh, on vulgarise tout. On commercialise. Ce n’est pas au poète de descendre vers la foule. C’est à la foule de monter. On comprend Racine ou non. On accepte Wagner ou non. Mais on ne se contente pas de facilités. Et nous n’avons pas à expliquer le b.a.ba. des grandes œuvres. Le cinéma, art vulgaire, commerce grossier, est devenu l’idolâtrie nouvelle. On se pâme devant des héros de pacotille collés à des décors de carton. Le commercial, c’est ce qui est compris par le plus grand nombre. La vérité a très peu d’adhérents. Elle est rarissime. Elle n’est compréhensible que pour ceux qui se sont donné la peine de la comprendre. Et pour le reste, tant pis, ce sera pour plus tard.
Le goût de la foule est toujours mauvais. Elle préfère Sardou à Corneille, Scribe à Musset, Zola à Baudelaire, Bernstein à Claudel. La foule ne lit pas. Elle dévore les bas morceaux. Elle va toujours au moins cher, non pas qu’elle n’a pas d’argent (elle dépense des fortunes pour le tabac, l’apéritif et la boustife) mais parce qu’elle n’a pas de goût. Et le goût est une discipline rude, un savoir-vivre longtemps remâché. Les bourgeois non plus n’ont pas de goût mais ils donnent, par snobisme, leur argent à ceux qui en ont pour eux. Ils font vivre Matisse, Derain, Bourdelle, Maillol. Ils achètent quelque fois le meilleur parce qu’ils sont guidés par de bons antiquaires. Ils applaudissent Anouilh. La foule préfère une histoire de crémier qui épouse la duchesse, une histoire de duc qui séduit l’orpheline, et surtout, avant tout, l’épopée merveilleuse de toutes les Dédée d’Anvers, de tous le Dédé la Musique. Je ne veux plus être commercial. J’ai rompu avec le monsieur qui se prêtait à ces compromissions. On se salit toujours à se vulgariser.
Donc je vais penser à mon scénario. Mais quel sera-t-il ? On verra bien.
Je t’embrasse, sur le bout des doigts, sur le front, sur le bout du nez, sur le chapeau, sur la plume et sur la boucle d’oreille.
Écris-moi tout ce que tu n’oses pas penser. Dis-moi tout ce que tu n’oses pas écrire. Pense tout ce que tu n’oses pas dire.
Tu étais très jolie. Tu es toujours très mignonne. Et je le remarque bien. Mes gros baisers.
J.