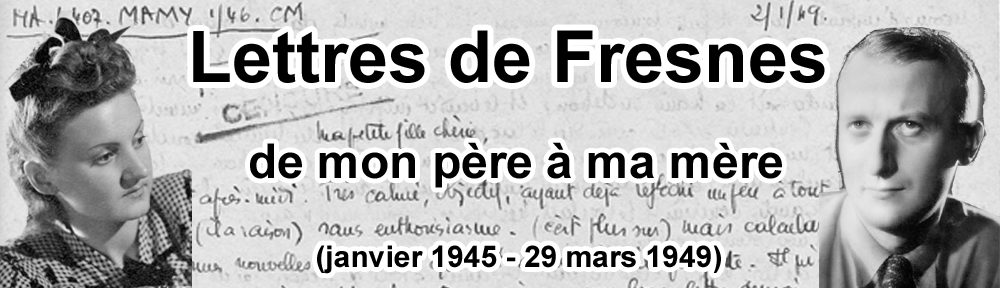Dimanche 9 janvier 1949
Ma petite fille très chérie,
Et bien oui, mon affection date du premier jour —et même d’avant— puisque chaque fleur est contenue dans sa graine, chaque amour dans son désir. Il est probable que je rêvais de toi quand, à sept ans, je cherchais sur l’oreiller une chevelure amie. Déjà à cet âge. Ne cherche-t-on pas depuis toujours. Je crois que si on t’interrogeait, tu avouerais m’avoir toujours pressenti.
On m’a dit que tu étais grippée. Ce n’est rien. Moins que rien. C’est déjà fini. Ce ne fût jamais. Ah même nous. Nous n’avons jamais été condamné. La chose en sera évanouie avant qu’il soit peu. Nous aurons toujours été dans la liberté. Absolue. Parfaite. Nous n’avons jamais connu que la paix –et non la geôle– que la douceur –et non la foule hurlante– que le silence et non point le prétoire.
Je suis emmitouflé dans des couvertures. J’ai néanmoins chaud aux pieds (chose indispensable pour que le cerveau soit frais) et je pense à toi qui doit grignoter d’excellents chocolats de nouvelle année. Pour moi aussi tout est parfait. Le gui et le houx sont près de ma tête, avec leur bonheur inoubliable. Sur la chaise des piles de bouquins pour la nuit (on s’endort tard, surtout avec une lampe allumée constamment). J’oublie les chaînes et les bracelets de chevilles (je n’y pense du reste jamais). Ma grande préoccupation est d’avancer demain mon deuxième acte. Si le rythme continue, la pièce aura été écrite au premier jet en trois semaines.
Nous avons parlé beaucoup d’Océanie cet après-midi, au préau, où l’on tourne en rond trois heures (excellent exercice mais qui n’arrive pas à me faire maigrir). Je t’y voyais dans ce Tahiti où la vie est facile, les soucis inexistants, le commerce agréable, la mer jolie. C’est là que l’on peut faire des enfants à foison sans crainte de les voir massacrer dans des guerres impies, où l’on évite la civilisation avec ses horribles contraintes, où l’on ne subit pas la grossièreté des masses avides, et où Jeannette sera la plus heureuse et la plus choyée des épouses. Il faudra évidemment un peu de temps pour qu’elle trouve là-bas la maison toute prête, avec les commodités de l’endroit, et qu’elle s’acclimate ; mais ceci n’est qu’un détail. Le but est là. Non point pour fuir le monde, mais pour se fixer dans un coin de tout repos, ce qui n’empêche pas de voyager comme on veut et de revenir Bd Diderot si le démon vous taquine. Toutefois, j’aimerais sentir sur la peau un de ces vents alizés qui n’apporte ni la révolution, ni la guerre, mais le souffle du large, plus fraternel que celui des hommes.
Je n’ai reçu de toi que ta lettre de mardi. Il ne me parait pas possible d’en avoir avant mardi soir. J’espère que tu as vu Leroy, que la note est tapée, qu’il a commencé le recours en grâce. Il me semble que le pourvoi en cassation ne sera pas rejeté avant la fin du mois. Veux-tu t’enquérir de cela. Dès lors nous déposerons le recours. Si quelquefois même cela dure, attendons. Je compte sur toi pour veiller au grain.
J’espère voir Leroy cette semaine, ou dimanche prochain. Nous examinerons la situation. Je crois que les événements politiques vont devenir favorables rapidement. Il faut gagner mars, avril, mai. Tout tend à la nécessité de l’apaisement, sinon à l’apaisement lui-même. Et cet apaisement ne peut être inspiré que par la volonté de l’étranger qui domine l’Europe. Attendons donc avec confiance.
Ici moral toujours parfait.
J’ai lu cette semaine quelques bouquins (romans stupides, sauf un de Somerset Maugham : le Fil du Rasoir [1], pas trop mal), un excellent Marcel Aymé, Le Maître de Santiago [2] où quelques répliques sont des meilleures, un très mauvais Camus, un mauvais Cendrars sur Jean Galmot [3], des brochures idiotes de cinéma (absurdes, vulgaires, pornographiques, où le cinéma français est-il tombé ? Quels acteurs pauvres ! Quels films abominables ! Même mes navets étaient supérieurs à cette tourbe !), quelques brochures scientifiques (on n’y parle que de guerre), deux ou trois bouquins d’histoire (de petite histoire, la seule amusante), un mauvais Gide : la Symphonie Pastorale [4] (je déteste de plus en plus cet hypocrite —ce fielleux— grand styliste, mais homme vicieux, pervers, faux —qui ne se mêle que de détruire avec une habileté de sadique. Gide m’est de plus en plus exécrable pour avoir pourri délibérément toute une jeunesse consentante au meilleur et qui n’a trouvé que ce guide souillé de lui-même. Je crois qu’il faudra exécuter un jour le personnage avec vigueur —reprendre toute son œuvre, analyser l’homme comme on dissèque un cadavre, et montrer le pus).
Voilà. Je t’embrasse. Du meilleur cœur. Je t’embrasse avec tous mes yeux, ouverts, fermés, ouverts, fermés… Avec tous mes bras, très serrés, pas trop serrés… Avec toutes mes épaules. Tempe contre tempe. Avec tous mes battements de cœur.
Écris. Ou si tu n’écris pas, pense si bien à moi, que ton image se dessine sur le mur. C’est ce qui arrive souvent. Entre quatre murs, c’est au milieu de multiples Jeannette. Tu m’as écrit des choses très gentilles. Parce que tu es très gentille. Dès le premier jour.
Mes grosses tendresses.
J.
PS. Ne m’envoie pas autant d’argent. J’ai besoin de 500 f par semaine. Pas plus. Et merci, merci, merci. Gros baisers.
[1] Le Fil du rasoir est un des grands romans de Somerset Maugham. Traditionnel par sa forme, il développe les thèmes chers au romancier : la quête d’une vie réussie, la découverte de l’Orient, la misogynie…Le héros, Larry Darrell, jeune américain idéaliste, renonce à un mariage d’amour pour aller voir le monde, sans trop savoir ce qu’il cherche. Délaissée, Isabel Bradley, choisit la sécurité, le confort . Elle n’aura de cesse, lors de leurs retrouvailles, de tenter de reconquérir un Larry toujours en partance. De Paris à la Chine, de la Birmanie à l’Espagne, il s’essaye aux métiers les plus pénibles, vit les expériences les plus déroutantes. Le Fil du rasoir est un vrai roman d’apprentissage riche de plus d’une leçon. C’est aussi le portrait ironique d’une société américaine qui singe l’Europe et sur laquelle Maugham exerce avec brio son génie sarcastique. (note de FGR)
[2] Le maître de Santiago, pièce en trois actes d’Henry de Montherlant parue en 1947 (note de FGR)
[3] Rhum, l’aventure de Jean Galmot reportage par Blaise Cendrars (première édition chez Grasset 1930)
Jean Galmot, homme d’affaires, homme politique et écrivain français né en 1879 et mort en 1928 à Cayenne (Guyanne). Ancien journaliste dreyfusard, il débarque en Guyane française en 1906 avec le titre de propriété d’une mine d’or, le Placer Elysée, non loin de Mana. Il y fait fortune grâce à l’aide des Guyanais. Il se fait mal voir des autres Blancs, car il partage tout avec ses associés guyanais, il achète une plantation afin de produire du rhum, encourant ainsi l’hostilité des autres exploitants, prêts à tout pour préserver leurs intérêts. Élu député de la Guyane en 1919, il est impliqué pour escroquerie dans « l’Affaire des rhums ». Arrêté en avril 1921 il est emprisonné à la Santé pendant neuf mois. Au terme d’un procès à rebondissements, en 1923, il est condamné à un an de prison avec sursis. Alors qu’il se représente aux élections en Guyane et que des émeutes éclatent à Cayenne, il meurt brusquement le 6 août 1928. Le bruit court qu’il a été empoisonné. Le procès des émeutiers de Cayenne, en 1934, établira qu’il n’en est rien. Son caractère romanesque au charme ambigu a fasciné des écrivains comme Blaise Cendrars qui le compare à Don Quichotte. (note de FGR)
[4] La Symphonie pastorale, roman écrit en 1919 par André Gide. Gertrude, une jeune fille aveugle et orpheline de sa tante qui vient de mourir, est recueillie par un pasteur qui lui offre de vivre avec sa femme, Amélie, et ses enfants dans une petite chaumière des Jura suisses. Dans son journal, le pasteur raconte l’éducation protestante qu’il offre à Gertrude, dont il finit par tomber amoureux. Son fils Jacques tombe également amoureux de Gertrude. Lorsque le pasteur s’en rend compte, il lui ordonne de rabrouer ses sentiments. Une opération donne la vue à Gertrude et, voyant le père et le fils, elle tombe amoureuse de Jacques plutôt que du pasteur, même si encore aveugle elle avait davantage de sentiments amoureux pour ce dernier. Jacques s’étant converti à la prêtrise pour respecter les vœux de son père, Gertrude ne peut plus l’épouser. La vue lui permet d’observer tout ce que le pasteur lui avait caché durant des années pour protéger le sentiment de bonheur qu’il avait tenté de susciter chez elle. Attristée par ses découvertes et après une tentative de suicide au cours de laquelle elle s’est presque noyée, Gertrude finit par mourir de folie quelques semaines après l’opération qui lui a permis de voir. Les décisions et prises de position du pasteur sont conditionnées par son interprétation de la Bible et par l’enseignement qu’il en a reçu. Si sa morale protestante lui a jadis permis de goûter au bonheur, elle finit par le rendre malheureux en suscitant un immense sentiment de culpabilité à l’égard de ses sentiments envers Gertrude et de son fils Jacques. C’est un roman qui traite du conflit entre la morale religieuse et les sentiments. L’œuvre a été portée au cinéma en 1946 par Jean Delannoy avec Michèle Morgan dans le rôle principal. (note de FGR)