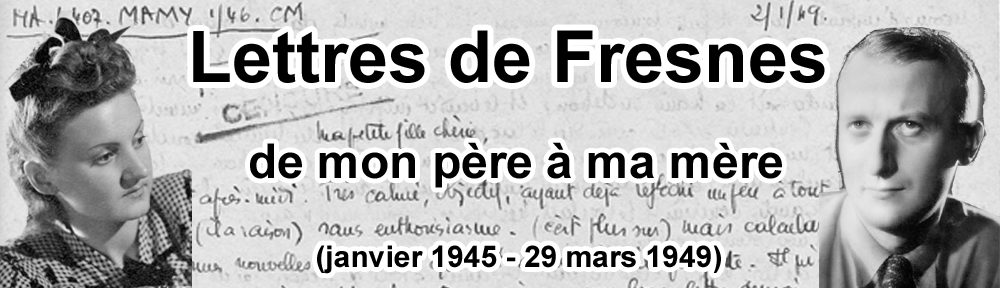Dimanche 2 janvier 1949
Ma petite fille chérie,
J’ai vu Leroy cet après-midi. Très calmé, objectif, ayant déjà réfléchi un peu à tout, voyant les choses prudemment (il a raison) sans enthousiasme (c’est plus sûr), mais calculant les chances. Il m’a donné de bonnes nouvelles de ma mère qui est d’une sérénité parfaite. Il m’a dit aussi qu’il devait te téléphoner demain matin et que tu avais reçu une bonne lettre de moi. J’en ai écrit deux (une sur ½ page et l’autre sur page entière). Veux-tu me confirmer réception.
Je lui ai donné une note relative au recours en grâce. Il faudra que je la révise dimanche avec lui. Je lui remettrai également d’autres indications dont tu auras connaissance. Malgré son avis —très sage— n’hésite pas le moment voulu à utiliser tes relations. Il faut que nous ayons le maximum d’atouts. Je ne suis pas du tout d’accord pour me laisser égorger vif par des excités. Je refuse ce jugement comme étant partisan. Tous les témoins ont menti par un bout. Et ce qu’ils n’avouent pas c’est l’état de guerre civile dans lequel était la France en 44. Nous nous en sortirons. Peu à peu la vérité gagne.
Je compte recevoir la visite de notre bon pasteur mercredi (et sans doute des deux). Ils te donneront sans doute des nouvelles de mon excellent moral.
Car je suis content pour de multiples raisons. D’abord j’ai gagné l’estime de quelques amis à qui je tiens. Les lettres qu’on m’envoie sont réconfortantes. La femme de mon avocat que je ne connais pas a pris parti pour moi. Elle plaisantait même son mari « si quelquefois on le fusille, dans peu de temps tu vas inaugurer la rue Mamy ». Mieux vaut réserver ce plaisir à nos héritiers. Pas vrai. Je ne suis pas si pressé de passer à la postérité.
Il est vrai que tout ce que nous avons prédit se réalise peu à peu ou s’entrevoit. L’Europe, dominée par le peuple le plus fort, le plus méthodique, le plus froid : l’Allemand avec qui le Français doit cohabiter et plus encore s’allier intimement s’il ne veut pas être détruit d’un revers de coude. C’est ainsi. Nous serons, ou nous aurons été, les champions d’une cause d’avenir. Je crois de plus en plus à cette fusion européenne, d’autant plus que l’Angleterre ne joue plus son rôle qui était de diviser et de fédérer. Si l’on veut éviter l’Asie à Brest, il faut faire l’Europe sur les Carpathes et plus loin encore si possible. Regardons la carte. Les hurlements de mes témoins devraient s’adresser à ceux qui les laissent sans défense avec trois maigres divisions contre une armée rouge qui n’a plus en face d’elle une Wehrmacht solide.
Mais voici que je fais de la politique quand je voulais te dire toutes amabilités. Sais-tu que je pense à toi un peu trop. C’est à dire pas assez comme il le faut. Je te revois comme hier et non dans le plan de demain. Je récupère tout un passé heureux, et je suis pourtant gonflé de beaucoup plus d’avenir. D’abord tu m’es devenue quelque chose, c’est à dire quelqu’un d’infiniment plus précieux et rare. Une sorte de sang nouveau. Un désir sur lequel on s’appuie ferme comme si l’on devait poser des pierres sur les mots qu’on dit et construire petit palais ou chaumière, mais home confortable à recoins d’amour, à recoins d’instants. La vie est faite de moments gagnés. Ces trois minutes dans le couloir de cour de justice où j’ai pu écraser sur tes tempes des baisers chéris comme de vieux papillons lentement séchés et qu’on colle vite en collection précieuse autour de l’image préférée, ces trois minutes d’yeux nourris d’un absolu émouvant qui surclassait la haine du dehors et le verdict impitoyable, ces trois minutes d’un haut amour qui sont l’entrevue éblouissante sur le lac doré, au milieu du tunnel grondant, comme si le ciel s’ouvrait un fragment pour lancer sur le cœur un couteau de bonheur. Ces trois minutes où j’ai regardé combien mon cœur avait mûri pendant quatre ans, combien il avait formé de toi une image chère et sainte, combien il te voulait heureuse, combien il n’avait plus peur d’être enfermé dans les limites d’une volonté personnelle.
Car j’avais peur de toi hier ; je me méfiais. Les femmes sont si pièges. J’ai été pris à toutes les corolles et je ne voulais guère me laisser approcher par tout ce que le partenaire contient d’animal. Car c’est le bon. C’est ce qu’on déteste parce qu’on y consent. On le subit. Mais dès notre envolée à travers l’espace, je t’ai conquise par le haut, je t’ai imaginée, vérifiée, découverte par l’inimaginable, le vrai, la nature jolie. Tu es devenue réelle, en ce sens que, rejetant le désir quotidien d’une présence avide, je t’ai aimée pour le sommet de ton sentiment le plus pur qui a fleuri d’un jet vers la grandeur. A se vouloir saint, on s’honore. Et l’autre monte avec vous. Je t’ai prise par la main et j’ai imaginé, senti, que nous allions du même pas sur une montagne où peu peuvent rejoindre. Tu m’y as précédé par le cœur, car où que j’aille, je t’ai devant moi comme une idée bénie. Voici que nos pas ne marquent plus la terre, que nous projetons des secrets plus intimes, que nous savons où nous rejoindre par le moyen d’une pensée rapide et calme. Il me semble souvent que je prends ta tête sur ma poitrine et te regarde vivre d’un souffle sans précipitation. Où est le temps où ton cœur battait trop fort. Plus d’émotions. Des lenteurs pures. Pour marcher jusqu’au bout, il nous faut cesser d’être troublés par des nerfs trop vivants.
Si tu sens quelquefois le soir, le calme tomber dans ta chambre ; si dans le silence et l’ombre, tu écoutes une voix haute, tu percevras que je suis là à t’aimer sans défaillance. Une caresse de parole pure, un mot perçu dans l’infini, seront l’écho de ma patience à te contempler sagement. Tu sauras que je veille sur nous, que je me protège contre tout mal qui pourrait atteindre la joie parfaite de cette tendresse plus qu’humaine. Je prie pour toi comme un petit enfant, pour que tu sois bénie à flots et que ta pensée soit parfumée de grâce vivante.
Il faut bien, un beau jour, qu’on arrive à parler d’amour d’un cœur délavé de toute illusion. Quand on a beaucoup vécu (loin de moi les blasés) on compare, on foule aux pieds, on déchire, et aussi, on sépare, on tue, on divinise. Le bonheur c’est de dérouler devant les pas de l’autre un tapis de prévenances. Il faut comprendre quand le cœur a soif, lui verser sa nourriture, lui donner ce qu’on avait toujours caché jusque-là, car il n’avait été possible de le donner à d’autres. Il y a des amours qui restent vierges jusqu’au jour où ils rencontrent l’élue. Figure-toi que tu as éveillé en moi des pensées neuves. Je suis devant toi comme devant un être nouveau. Devant moi aussi. Le printemps ne connaît rien que son élan. Nous connaissons tous deux la grande découverte. A nous d’en profiter.
Je t’embrasse avec tout le bonheur que je te dis. Laisse-moi penser longuement à toi ce soir. Je te verrai comme tu es aujourd’hui, puis comme tu seras demain dans le pays où je t’aurai emmenée, où les gens sont doux, la mer bleue, enfantine, et où la foule ne rugit plus. Tu y trouveras la maison ouvrée par des mains amies. Le temps ne sera plus coupé de fièvres malsaines. La ville ne sera plus le gouffre où l’on s’élance pour perdre la mémoire. Nous aurons le temps de compter les minutes heureuses.
Mes tendresses patientes. Je t’aime, toi.
J.