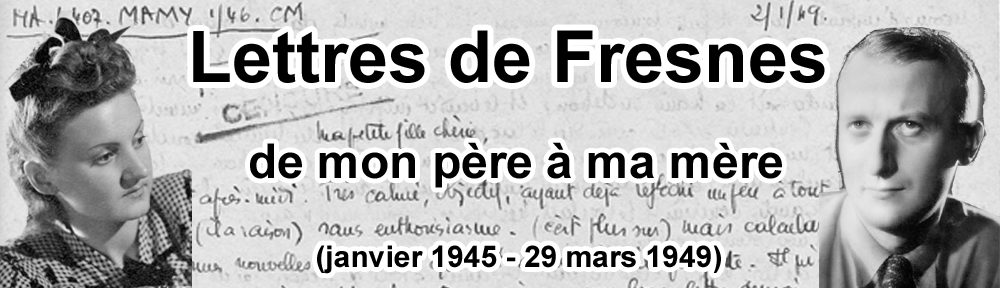Lundi 25 novembre 1946
Ma chérie,
Je dois tout d’abord te remercier pour le colis de ce matin. Tout y est si parfait et en telle abondance que je me sens un peu confus de ne pouvoir répondre autrement que par des paroles, par des doses d’amitié, des mots de tendresse, toute la reconnaissance de celui pour qui la vie se révèle comme ne frappant pas toujours, mais pleine de ces surprises de générosité qui touchent. Veux-tu bien téléphoner à ma mère, l’embrasser de ma part, lui dire que tout est magnifique : le pardessus et le sac (je crains d’avoir fait faire une grosse dépense, mais il m’est si utile) et tout le reste. Vous êtes bienheureuses, vous autres, avec vos mains pleines. Que pourrais-je bien faire pour vous remplir de joie et de paix. Nous écrirons vos louanges, mesdames, et vos vertus ! Et tout le bien qu’on pense de vous. Dire que je fus menacé d’être misogyne ! Je ne savais plus reconnaître les trésors du cœur. Vite nous allons effacer ce passé furieux et vous assurer de toute l’estime, de tout l’intérêt, désormais averti, que nous portons à ces compagnes maternelles ou frédériciennes, dont les pas menus cheminaient vers nos avocats ou nos amis, dont les mains expertes ficellent des paquets de vivres, dont le cœur battant attend la paix du monde, ou la liberté des bons combattants.
Les nouvelles générales ne sont point trop mauvaises. Recul du désordre dans France. Décisions de fermeté implacable dans les pays civilisés contre cette Russie communarde où l’on continue à tuer et déporter au nom de la défense de la personne humaine. Il nous semble que le vent devient plus doux pour nous. Veux-tu bien au reçu de cette lettre confier à Flo. Les documents de défense que tu auras pu trouver et que je t’ai indiqués (numéro du Peuple). Recherche à la Nationale un numéro spécial de La France au Travail [1] d’août 1940 consacré à l’anniversaire du pacte franco-soviétique et où l’on publiait la double photo d’Hitler et Staline. Si cela n’est pas trop cher, demandes-en une photocopie. C’est un des points capitaux de mon argumentation. Autre chose : va 3 Cité Falquière ou Falguière (15ème) au siège de la revue Review of World Affairs rédigée par Kenneth de Courcy (elle est rédigée en anglais). Il faut retrouver un numéro de 1945 où, parlant de la situation en France, on donne le chiffre des victimes de la Libération (80 ou 120.000). C’est également un des points importants à éclaircir. Les dernières campagnes de journaux de droite nous sont des plus favorables. Peu à peu on découvre la vérité.
Veux-tu bien vérifier qu’on remette la note prévue à la rue B. d’A [2]. le samedi 30 novembre et pas avant. Téléphone à Liebermann à ce sujet. Et qu’on obtienne un nouvel interrogatoire aux environs du 15 décembre pour dernières explications. Tout cela est très possible. Pour Flo., dis-lui que je fais le nécessaire pour ce qu’il me demande. Je suis obligé d’emprunter, mais étant donné la valeur actuelle du franc, cela me sera sans doute possible. En tout cas, l’appel est lancé, et je compte bien avoir satisfaction.
Si tu pouvais trouver tous les renseignements possibles sur le groupement France-Europe qui fonctionnait rue de Bondy de 1940 à 1942 (chefs, responsables, etc…), fais-le. Tu pourrais peut-être (en désespoir de cause) d’adresser à Husson, dont tu connais l’adresse.
As-tu fait des démarches auprès des éditeurs ? Tiens-moi au courant de tout ce qu’on t’aura répondu. J’ai donné à Flo. une notice à taper en plusieurs exemplaires et à conserver. Tu m’en enverras un double pour vérification. Il faut présenter l’ouvrage sous ce signe. Je suis persuadé que l’étranger réagira très favorablement. C’est le moment. Si l’on peut aller très vite, ce peut être très favorable pour nous. Si tu n’as rien, préviens-moi vite. Je crois pouvoir toucher quelqu’un.
Je reçois à l’instant ta lettre de vendredi. Alors, tu penses encore à ce qui s’est passé il y a 26 mois. Mais il n’y a pas d’épreuves qui doivent vous émouvoir, non plus de rêves qui doivent déranger vos coiffures virginales. À Florence, sous les Médicis, où l’on s’entre-tuait autant et même bien mieux qu’aujourd’hui, les femmes s’efforçaient (devant leurs peintres) de conserver des poses extatiques pour ne montrer à l’humanité enflammée de passion que le visage souriant d’un bonheur intime. Si j’avais à te peindre, je te placerais contre un mur sombre, ornée de tapisseries au dessin flou et peu éclairées. Drapée dans une tunique d’un bleu violent et lourd. Avec un collier d’or massif autour du cou si rose. Manches longues, brodées et terminées par poignets de dentelle. Mains si menues que bijoux. Peu de bagues, mais fines. La tête de trois-quarts. Très ornée de boucles luisantes et souples. Un ruban aplatissant quelques mèches rebelles. Petites perles précieuses aux oreilles. Sourire esquissé, mais pas trop large pour garder l’afflux de tendresse derrière un masque de timidité. À tes pieds, le Frédéric si riant qu’il en éclabousse la pièce au lourd plafond de poutres dorées. Par les deux fenêtres qui s’ouvrent de chaque côté de cette vierge centrale, la campagne florentine avec des perspectives de collines bleuies semées de cyprès sur fond d’oliviers, où les lourds bœufs blancs aux longues cornes labourent la terre rouge. La lumière est si douce dans l’intimité de cette salle bienheureuse que le peintre est obligé de parsemer légèrement l’ambiance de rayons d’or, autour de la tête bleuie de la femme, autour de celle de l’enfant, à travers les nuages où le soleil promène ses pinceaux sur la plaine. Par la fenêtre si éblouissante de vie que le bonheur ouvre toutes les portes trop verrouillées du cœur du spectateur intimidé devant tant de gloire secrète. Maintenant que le tableau est peint, suspendons-le au sommet de notre sommeil pour qu’il garde nos rêves impatients de s’ébattre, et pénétrons dans l’intimité du modèle. Là on ferme les fenêtres pour chasser sur ses domaines la lumière trop vive et rétablir la pénombre à travers les vitres brouillées où les vieilles couleurs chatoient entre leurs dessins de plomb. On porte l’enfant endormi dans son berceau où il continue à vivre son sourire que prolonge la musique des anges. Et l’on prend la dame par la main pour l’asseoir sur nos genoux. Il faut prendre garde de ne point froisser la robe, à ne point friper la dentelle du corsage, à ne point blesser les frêles oreilles percées d’or. Et, jusqu’à la veillée, on racontera des histoires de paradis entrecoupées de silence sublime, tantôt pour aller fermer les volets pleins à l’heure du crépuscule, pour tisonner le feu qui lèchera les vieux murs de son poème ardent, tantôt pour compter l’heure quand le timbre du souvenir s’éveille. La nuit apaise tout le rut du dehors. Le vent apporte la chanson des étoiles. Ce sera le moment de prier plus haut pour que les cœurs brûlent d’un feu plus rouge et de s’endormir la main dans la main, afin de n’être point séparés par les démons étranges. Et le premier rayon du matin frappera les yeux clos de la vierge d’un tel flot de tendresse qu’elle ne sentira plus la douleur de vivre.
Est-ce que tu sens combien la vie est puissante pour guérir, prolonger, protéger, magnifier l’homme ? Il est des plantes qui périssent dès le premier orage. Il en est d’autres que la pluie ou le vent, ou la graine, ne tourmentent point. J’ai en ce moment sous mes fenêtres mes bons amis Cousteau et Rebatet qui se promènent chaînes aux pieds avec six autres condamnés. On s’envoie des souhaits et des bonjours. On espère, et l’on croit. Et les huit hommes que la IVème répugnante a voulu supprimer rient, vivent par-delà l’actuelle boucherie en sachant qu’ils ont déjà en eux toute la plénitude du ciel. À se détourner de la terre et des luttes humaines, ils deviendront peut-être doux comme des agneaux bénis. On ne comprend jamais autant la vanité des choses que sous l’adversité. Et jamais le Christ ne fut plus puissant que crucifié. Vaincre la foule est moins que vaincre la mort. Nous n’avons plus de crainte, puisque nous refusons de courber la tête sous les huées.
Ainsi tu vas écouter la môme Piaf et voir le Mariage de Figaro ! Mais c’est très mal. La môme Piaf est une horrible petite laideronne qui racle des goualantes à la gloire des femelles sans âme qui croupissent à l’ombre des taudis. C’est du printemps rabougri, de la violette à deux ronds, du faisandé populaire, de la salle petite chansonnette pour gogos sans culture et bourgeois faisandé. Elle sue son Sébasto [3], sa rue de Belleville, ses six jours [4], tout ce qui est détestable dans cette République quarante-huitarde. C’est la vedette popu, malheureuse, grincheuse, mal foutue, mal nippée, pleurnicharde et mendigote : la fleur du ruisseau, fanée et échappée de la poubelle. Quant au Mariage, c’est, sous des dehors étincelants, la critique la plus fausse d’une société qui avait bien du mal à se survivre. Nul héroïsme. Que des traits d’esprit. Même pas de coups d’épée. Beaumarchais tue la noblesse avec un porte-plume. Il est vrai qu’elle s’est laissé faire. Tant pis. C’est déjà le glas d’une civilisation glorieuse.
Il semble que nous soyons les nouveau-nés d’un prodigieux avenir. On peut nous étouffer dès le berceau. On n’assassinera pas les idées que nous portons en nous. Le bouquin de Lange [5] est prodigieux. Il exprime toutes les idées que nous avons promis pendant quatre ans. Pourquoi nous assomme-t-on alors que dehors paraissent des livres qui sont nôtres.
Si je t’embrassais derrière l’oreille, quelles pensées t’animeraient. C’est là où on peut parler le plus doucement, et dire à mots lents, ce qu’on pense le mieux. Vais-je le dire ? Il vaut peut-être mieux réserver les grands mots pour les grands moments. Mais oui, nous nous retrouverons, libres de nous mouvoir sans garde-chiourme, dans notre maison de Florence, ou notre ferme du Canada, ou notre hacienda d’Argentine, ou notre hutte de la Côte d’Ivoire, ou notre palais chinois, ou notre tente de camping, ou notre petit chez nous d’un quelconque quartier de Paris, sous le parapluie radar antiatomique. Si je t’embrassais je te dirai de tendres choses. Eh bien ! Je t’embrasse ! Et pour les tendres choses, je vais essayer de faire battre ton cœur très fort. Es-tu prête ? Voilà. Il y a un mot que je voulais te dire. L’entends-tu ? Écoute bien. C’est un grand, un immense mot ! Le plus lumineux, total, infiniment vivant. Ce mot c’est : Oui !!… Gros, gros, gros… C’est bien oui.
J.
PS. Dis à ma mère de me faire envoyer 1000 frs sur mon compte.
[1] La France au travail, organe collaborationniste fondé par l’avocat André Picard, pendant l’Occupation et dirigé à l’origine par Charles Dieudonné et Jean Drault. Henry Coston en fut le secrétaire de rédaction. Le premier numéro sort le 1er juin 1940 avec comme sous-titre « Grand quotidien d’information au service du peuple français ». Le journal ouvre ses colonnes à des personnalités comme Georges Montandon, qui y écrit : « En sus de ses fautes à elle, la nation française a été empoisonnée par l’esprit de l’ethnie putain » (2 juillet 1940). Rédigé par des gens de droite mais créé pour attirer un lectorat de gauche, le journal tirait à plus de 180.000 exemplaires en août 1940. (note de FGR)
[2] Rue Boissy d’Anglade, où se trouve le cabinet de Maître Floriot (note de FGR)
[3] Le Boulevard Sébastopol (quartier populaire du centre de Paris)
[4] Six jours : course cycliste ultrapopulaire en équipe qui durait 6 jours, 24h/24h et qui se déroulait sur la piste en bois du Vélodrome d’hiver (le Vel d’Hiv’) de la rue Nélaton, celui où furent concentrés les juifs lors de la rafle du 16 juillet 1942.