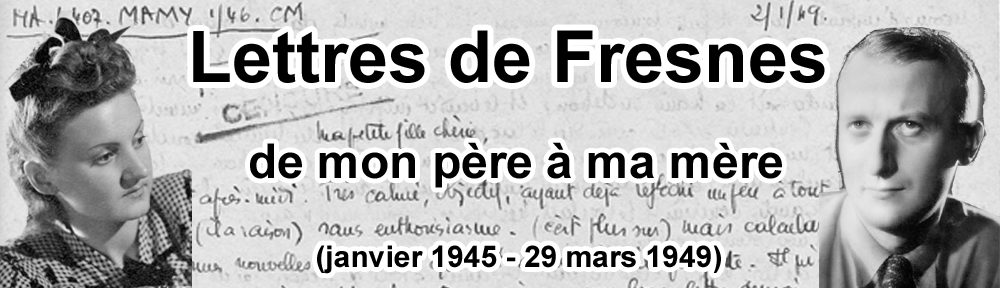Lundi 19 août 1946
Ma chérie, toute petite Jeannette, toute chérie,
Je viens de recevoir ta bonne lettre si tendre, si douce, si pleine de grandes choses, d’arrière-pensées, de désirs, de tourments peut-être, d’inquiétudes, et il faut pour une fois à abandonner ce ton poétique, badin, pour prendre à deux mains la tête de ma Jeannette, pour la mettre tranquillement sur mon épaule et la calmer comme un oiseau. Mais non je n’étais ni courroucé ni furieux, ni de mauvaise humeur, mercredi dernier, et ma joie est entière comme toujours puisque tout est retrouvé (et même si cela n’avait pas été retrouvé, je n’en aurais point fait un drame). Je n’ai jamais perdu mon sourire, celui spécialement dévoué, dévolu à Jeannette. Tout va fort bien. Je suis le plus heureux du monde, à condition que tu sois tranquille, sage, heureuse. Et surtout pas d’inquiétude pour les projets, ni les souvenirs, ni le présent, ni la patience à avoir. Les uns comme les autres sont inscrits dans un cycle harmonieux où il nous faut dépouiller tous nos nerfs, toutes nos impatiences, tout le mal du monde, pour retrouver la quiétude éternelle, la joie de vivre, et vivre bien. Donc pas de cris, pas un ciel gris, pas de tristesse, je suis beaucoup plus infiniment plus adouci que tu ne crois. Et si cela te réchauffe, je te dirai à l’oreille la belle histoire que tu attends. Sacrée petite fille. Une histoire à dormir sans rêver. Un conte de fées tout bleu. Avec des amoureux satisfaits, des enfants en grand nombre, des carrosses et des châteaux, des cailloux blancs tout le long de la route.
D’abord, ce matin, je suis infiniment content pour des raisons toutes spéciales à moi que je te dirai un jour, et qui touchent à nous deux. À force de s’explorer, on se découvre, et j’ai vu que dans le compartiment « Jeannette » avaient mûri des fleurs d’une beauté rare. Il se trouve qu’elles sont d’une substance plus immatérielle, plus définitive que les autres. Il se trouve même (n’en soit point orgueilleuse) qui n’y en a point d’autres (tout au moins dans le chapitre du sentiment, car l’intellectualité, la philosophie, la métaphysique y ont leur jardin, mais dont tu n’as pas lieu d’être jalouse, au contraire, car ils sont aussi bien tous généreux). Je te dirai encore davantage un jour. L’amour n’est-t-il pas de dire toujours davantage ? Nous sommes dans l’infini de la multiplication quand l’infini ouvre ses pétales, et ses feuilles, et déploie ses branches, et renaît, et repousse encore, plus nombreuse, plus fournie, mieux nourrie. Je suis sûr d’apprendre encore que chez toi il y a de ces sources dormantes, de ces lacs souterrains, de ces grottes mystérieuses (où rodent d’invisibles lutins bienfaisants) qui ne cherchent que l’homme armé de sa lampe qui viendra les explorer en maître et y boire. Petite fille douce ! Amie ! Ne sois ni contrainte ni rebutée par les apparences. Pourquoi as-tu cru qu’un monstre enfermé dans une cage à poules te faisait les gros yeux ? Tu sais que les plus grosses bêtes sont les plus gentilles, les plus facile à conduire, par les tout petits bouts de femme aux doigts fins. Il est parfaitement docile ce monsieur furieux, et il te remercie tant du premier envoi que tu lui fis (comme de tout ce que tu lui donnas) qu’il est confus de la peine que tu prends pour lui faire plaisir jusqu’au bout et lui taper ses pattes de mouches, dans quoi il essaya d’enfermer le ciel et la terre.
Voilà, chérie aux cheveux blonds, tout ce que nous pensons de la vie passée, présente et future pour aujourd’hui. Bien que nous ayons eu dès notre réveil d’autres sujets de préoccupation. Des camarades nous ont quitté, de bonne heure, pour aller se faire découdre à Châtillon. Et dans les cris qu’ils ont poussés en partant, il y avait tant d’amitié, d’espoir, de courage, de christianisme. Il a fallu passer l’éponge dans nos esprits, calmer les battements de nos poitrines, dompter les vagues de folle indignation qui menaçaient de nous émouvoir, et prier. Car nous ne savons plus guère faire autre chose en face des coups que de nous appuyer de toutes nos forces sur une Paix suprême qui n’émane pas des hommes, mais vient d’un Esprit, d’un idéal plus haut, plus intime, plus profond que la terre, de cette Harmonie devant quoi la vie mortelle s’efface, pour ne laisser place qu’à la joie de l’Amour parfait. Voilà ce qui nous maintient, nous aide à vivre. Voilà pourquoi en des temps si troublés nos lettres, nos paroles, sont joyeuses. Voilà pourquoi nous sourions plus souvent que nous sommes atteints. Voilà pourquoi nous répugnons à tous les arguments qui veulent qui veulent menacer notre vie réelle, celle qui domine sur toutes les pauvres pensées suggérées par l’esprit du monde. On ne fera plus de nous ni des victimes, ni des bourreaux. Nous sommes bien libérés de toutes luttes, et dans l’amitié fraternelle que nous témoignons à tous – même à nos ennemis qui en sont les moins dignes – il y a le ciel retrouvé.
Car le ciel n’est pas de nuages. Il est bleu, éternellement. Ceux qui sont tombés, frappés dans leur chair éphémère, le retrouvent dans l’esprit. On n’est jamais mort qu’à une chose à la fois. Et ce qu’ils ont gagné vaut sans doute mieux que ce qu’ils ont quitté, car ils ont monté d’un échelon l’escalier de la paix plus forte, du courage plus lucide et transcendant.
Voilà ce que je me suis plu à regarder les rubans que tu as mis dans tes cheveux le jour de ta photo souriante, puis la bruyère qui dure sur ma table, puis les fleurs qui s’épanouissent à la fenêtre. Tu m’entoures toute entière, chérie, et cette cellule est pleine de ta présence, de même que mes yeux sont pleins de cet amour difficile, rare, d’une extrême ténacité, si solide, si plaisant que tu m’as jeté autour du cou comme une corde. Celle des pendus porte toujours bonheur. Ne crois pas m’avoir lié. Tu m’as plutôt délié de ma paresse d’aimer. Sans toi, j’aurais continué à crier sur les toits. Il faut que je sente s’agiter cette poche gauche symbolique pour savoir que les luttes humaines ne nous honorent point si on ne les sacrifie pas sur l’autel de l’affection familiale, amoureuse, de l’amour absolu.
Est-il vrai, vrai ? vrai-vrai-vrai ? que, comme tu l’as déclaré solennellement la dernière fois, tu me suivras partout – « où tu voudras » as-tu dit. Tu l’as dit. Tu l’as dit ! Je suis certain de l’avoir entendu. C’est dit ! Promis ? Faut-il le croire ? Je n’en douterai point.
Ce n’est pas parce que tu as un bel enfant (splendide, intelligent, extraordinaire) qu’on t’aime. Ni parce que tu en veux d’autres avec ce généreux dévouement maternel qui te fait désirer la vie et son expansion. C’est parce que tu es très gentille. Et puis par égoïsme. Voilà. Cela nous fait plaisir de t’aimer. Et nous cédons à notre plus haut plaisir. S’il te convient.
– Choses pratiques : peux-tu dans le prochain colis penser à
- du sel fin
- puisque le poivre est défendu, mets moi un ersatz, condiment quelconque, qui en se délayant puisse faire une sorte de moutarde
- n’oublie pas la margarine, très utile
- as-tu trouvé quelques petits bouquins – théâtre grec et autres – demandés ; ne te dérange pas pour tout cela – je te le rappelle à tout hasard
- c’est tout. Je verrai tout à l’heure au reçu du colis s’il y a autre chose.
Si. Je t’autorise à avoir tous les souvenirs que tu veux. Et aussi tous les projets. Mais j’espère que tu préfèreras encore les projets aux souvenirs ? Quoique les souvenirs !!!
La situation générale va dans le sens que je t’ai dépeint. Nous allons vers des solutions, peut-être plus rapides que prévues.
– Reçu colis. Il est plus que parfait. J’ai tout déballé, mis en boîte, rangé, coupé les queues des roses, me suis gratté trois fois ce qui me sert de support à frisotis pour savoir quel pouvait bien être le nom des fleurs blanches à cœur jaune et vert. Elles sont en train de baigner dans une vieille boîte de conserves qui est le plus délicieux des vases d’appartement. Je regarde avec une attention mieux que particulière les photos du mur. Les doigts de Frédéric ont-ils touché ces fleurs ? Que trouverai-je donc dans ces pistils ? Quelles pensées encloses sous les roses ? N’y aurait-il pas des photos de Jeannette dans les pétales ? À propos, je suis très mécontent. On m’avait promis de se faire photographier avec un appareil dévoilé. On m’avait dit que bientôt je pourrai espérer de nouveaux clichés. Et on n’a pas tenu parole. On se dérobe. On n’en parle plus. On espère que je n’aurai pas de mémoire. On se trompe. On est donc prié de réparer au plus tôt cet oubli. On aurait tort de croire que ces choses doivent ou peuvent être négligées. Que l’on se le tienne pour dit.
Et pour réparer ces méchantes paroles, pour adoucir cet air sévère, nous allons nous amuser à décrocher des boucles d’oreilles, à fourrager des cheveux, à défaire des rubans, à rallumer ou éteindre des bougies, à tisonner le feu, à écouter le cœur qui bat, à ne plus compter les heures, mais les secondes où le sang saute dans les veines de la joie, à éprouver la rudesse des tapis, comme le souffle du vent qui hurle dehors, et dedans aussi, à recommencer sans cesse le chemin des douceurs, à fermer les yeux, à les rouvrir et à regarder la vie qui court à travers la brume des pupilles, l’avenir qui s’épanouit au fond des corolles, la fièvre des grands élans. Dors bien. Sois tranquille. N’aie plus de mauvaises agitations dues à je ne sais quel soupçon lu n’importe où. Et vient me voir vite. À jeudi en huit. Viens toute seule, toute neuve, dans ta robe rose, ou grise, avec ou sans rubans. Je te laisserai parler tout le temps et tu t’en iras très contente parce que je t’aurais tout dit gros, gros, gros… b.
J.
PS. Des enveloppes SVP