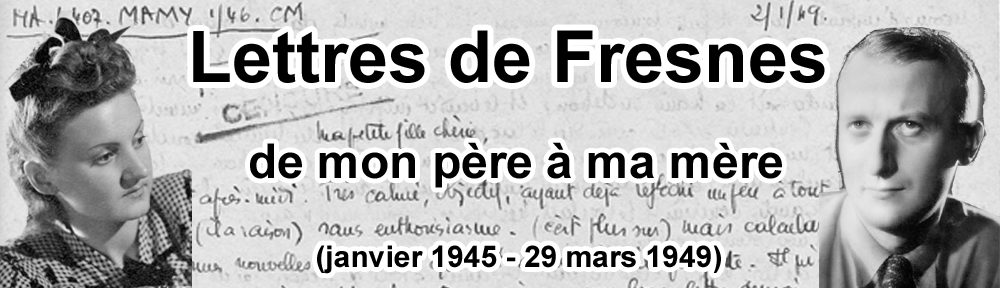Lundi 15 décembre 1947
Ma chérie,
Un bon petit mot de toi hier. Lettre moyennement longue, bien remplie de bonnes choses, un bon côté de tendresses – qui vaut bien l’autre. Je suis sensible à tout ce que tu penses. À propos tu ne m’as jamais donné ton avis sur les écrits fameux que tu as tapés. Que te semble de La Cuve à serpents et d’Empyrée ? N’aurais-tu point gouté de tels exploits ? Les aimes-tu au moins un peu ? Un petit peu ? Est-ce que cela te parait intéressant, digne d’une attention féminine ?
Je t’écris rapidement ce soir, trop à mon gré. Un grand nombre de mes meilleurs camarades partent à l’instant pour des camps ou prisons en province et j’ai dû embrasser des tas de braves gens honnêtes ; les amis nous quittent, d’autres restent. On se sent plus rattaché à l’éternité. J’ai déjà vu défiler tant de gens. Les uns avec qui je me suis fâché, d’autres qui sont pour l’instant des compagnons de combat et de captivité et pour qui évidemment j’éprouve la plus tendre sollicitude, pour ce qu’ils ont été, pour ce qu’ils seront encore – car la vie commence – déjà lourde d’expérience – mais remplie de promesses.
Ainsi l’on se connait, ainsi l’on se quitte. Ce sont les mêmes que j’ai vus partir pour l’Allemagne, revenir vaincus ; échapper pour la plupart au châtiment le plus implacable et s’en aller du même pas vers la bataille, vers le tribunal, vers la centrale, vers la vie politique intense, sans jamais cesser d’aimer les idées pour lesquelles ils auraient sacrifié leur vie. Les uns les avaient apprises dès l’enfance, les autres les ont glanées en route, à la suite de cruelles expériences, au risque d’être durement frappés par la haine aveugle. On se sent parfois ici dans la plus pure exaltation du loyalisme politique dont nous ornions notre drapeau, celui qui comportait des mots d’ordre généreux, où l’on voulait vraiment la résurrection d’un peuple qui se laisse aujourd’hui lentement engloutir par l’abime.
Un ministre de mes amis me disait tout à l’heure que la période du Directoire avait été entachée de la même corruption, de la même illégalité. Contre toutes les volontés nationales un gang s’était installé qu’on fut obligé de balayer pour que revive la classe productrice. Les hommes ne changent guère. Les procédés de la canaille sont toujours les mêmes. Les sectaires restent prisonniers de leur volonté partisane. Nous n’avons rien à attendre de ceux qui nous accusent. Peut-être nous reprochent-ils la même intransigeance farouche. Nous n’avons pas toujours été tendres. Il est des disputent qui tournent à l’aigre. Celle-là va plus loin que les autres. Il semble bien que ce soit la plus grave des crises françaises – après les guerres de religion et l’Édit de Nantes.
Que nous voilà loin de nos cheveux blonds de Jeannette toute tendre qui ne vit que pour son Frédéric et pour le colis du dimanche peut-être. Je te sens arriver tous les lundis. Dès 7 heures un petit ange frappe à ma porte qui me dit des choses que je ne répèterai point ici pour ne pas effaroucher le papier. Et quelques heures plus tard je trempe précipitamment dans l’eau les fleurs de l’amour, les tendres dons du cœur parfait.
Est-ce que tu patientes, aussi calme qu’il le faut ? Est-ce que tu sais que nous allons bientôt régler notre vie d’une autre façon ? Tous les cauchemars passent. Tous les printemps renaissent. Est-ce que tu crois que le Père Noël est une simple annonciation d’une nouvelle phase d’attente, ou bien le réalisateur tendre qui tient toujours ses promesses ? Je ne crois pas que nous en ayons pour bien longtemps à soupirer trop. D’ici là, aurais-je le temps d’écrire l’œuvre que je médite ?
Ma Jeannette, si tu m’écris (et tu ne m’écris guère) rajoute-moi des fleurs d’amour à tes phrases déjà si tendres. Écris-moi comme tu joues du violon avec âme ! Sais-tu que je me prends quelquefois à chanter à tue-tête dans ma cellule ? Tout seul ? Ma voix de casserole se forme un peu. Dans les basses j’ai des vibratos russes, dans l’aigu du ténorino italien ; et je pousse quelques sons qui doivent faire se réveiller les veaux près de leur mère laiteuse.
Le monsieur mercredi t’a-t-il remis le paquet ? Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es mon moineau fidèle.
Depuis hier je cherche un poème qui a disparu. J’ai du le brûler. Et je ne m’en souviens plus ! Quelle perte pour l’humanité ! Très joli mon poème. C’était l’histoire de la porte du ciel. Un tout petit trou d’aiguille par où passait la lumière à travers un mur d’une épaisseur incommensurable. Il fallait se réduire à la dimension du trou. Avec l’humilité voulue on y arrive fort bien. Et je crois que j’étais passé de l’autre côté. Mais mon poème a disparu en route. Humilité supplémentaire. Il n’y a plus de support de matière pour rejoindre l’esprit.
On t’embrasse. Très pieusement, mais aussi très fougueusement. Et puis avec toute la tendresse qu’il faut pour que tu prennes patience jusqu’au bout de l’épreuve. On se dit qu’il est des années qui passent comme l’éclair et des minutes qui sont des heures. Le malheur ne dure pas, c’est la joie qui est notre éternité. Je me sens tout jeune et tout petit enfant. Est-ce que tu voudrais de moi pour Frédéric ? Embrasse-le un peu pour moi. Je me rattraperai à la sortie. Gros, gros b.
J.