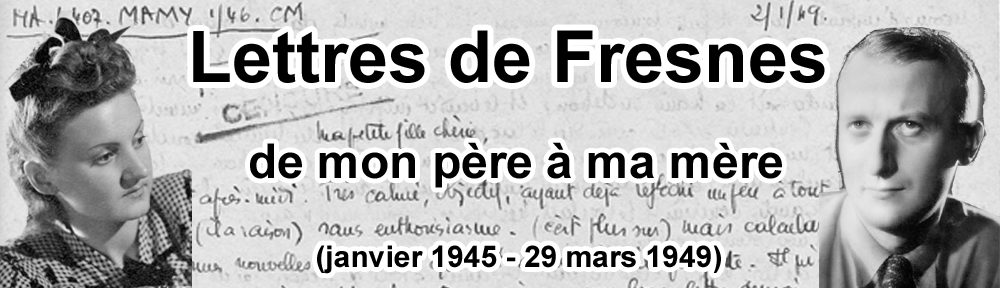Samedi 24 mai 1947
Ma petite fille chérie,
J’ai reçu (enfin !) ce soir ta lettre de jeudi. Paresseuse, hein ? Jeannette ? Alors, tu t’ennuies ? Mais c’est très mal. Il n’y a aucune raison de s’ennuyer, de se tourmenter, d’être impatiente, de penser à des choses tristes, de croire qu’on a encore très longtemps à attendre, de croire qu’on a encore beaucoup de temps pour tout le travail qui reste à faire, de croire qu’il ne faut pas se dépêcher, de croire que Catherine est très impatiente aussi (elle est beaucoup plus sage que vous, Mamzelle, elle mûrit à sa place, elle sait qu’elle ne peut arriver que dans un monde en paix, pas bousculé du tout, et guidée par une maman qui, depuis longtemps, doit se préparer à être la plus calme, la plus confiante, la plus tranquille de toutes les créatures du Bon Dieu). Catherine, elle, ne désire en rien brusquer son apparition ici. Elle a beaucoup mieux à faire qu’à solliciter impérieusement de ses parents une entrée orageuse dans un univers déchiré. Au contraire, elle a décidé, et on a décidé pour elle. Et c’est très bien ainsi qu’elle soit déjà obéissante, qu’on devrait longtemps se préparer pour qu’elle soit la plus pure de toutes les filles qui ont ici à donner au monde sa valeur capitale, son élan inspiré et pour ce, Jeannette n’est peut-être pas encore prête. Il lui faut apprendre à n’avoir plus d’ennui, et à concevoir la vie lente, sage et douce.
On t’embrasse tant, petite fille, que tu ne t’ennuies plus. Bien plus, on sait déjà que tout est très bien, que tu as tout compris et que tu écoutes les messages qu’on t’envoie. Nous n’avons pas besoin d’appareil radio nous autres pour savoir que tout va si bien, que la vie en est toute miraculée. Et je regarde d’ici tes yeux tout mouillés de bonheur et tout pleins de leur absolue confiance. Voilà qu’ils rient. La soirée est si douce. Tout à l’heure un long rayon de soleil a illuminé mes œillets d’Inde qui repoussent. Ce sont les graines de l’année dernière que j’ai conservées et plantées. Et j’ai repiqué avec elles toute ma tendresse. Elle fleurira. Elle pousse déjà beaucoup plus fort que l’année dernière et nous avons le temps de penser à elle avec tout le soin approprié. Vous autres, perdus dans les méandres des soucis quotidiens, emprisonnés dans vos luttes vous ne connaissez pas la liberté qu’on a ici, qui nous permet de surveiller le développement des fleurs les plus belles, des pensées les plus hautes et les plus simples, du cœur le mieux guéri, plein d’un sang vif et gros de dons constants. Et si tu avais le temps de sentir en toi combien la source est gonflée comme un fleuve puissant qui cherche sa voie, tu comprendrais que la vie commence, que tu n’en n’a perçu que la plus infime partie et qu’il va te falloir apprendre combien tu es neuve, et féconde, et digne de toutes les promesses.
Pour ce soir samedi, je ne t’en dirais pas plus, car le papier manquerait. Merci à la rue Ampère pour sa très délicate attention. Dis-lui que je suis sensible à ses très bonnes amitiés, que je lui adresse les miennes avec effusion et que je lui souhaite, ainsi qu’à tous, tout le bien possible. Nous redonnerons un jour à la France son vrai visage d’affection, de générosité et d’art. Et c’est nous qui effacerons les taches des autres. Nous serons fiers de panser des blessures que nous n’aurons pas faites. Les honnêtes gens peuvent savoir ce qu’est une révolte contre l’anarchie. Ils ne connaissent pas la haine.
Remercie aussi mon camarade quand il t’apportera les bouquins. Dis-lui qu’il a bien eu tort de nous quitter. Ici nous lui remontrions le moral, et il verrait beaucoup plus justement que dehors l’évolution des choses. Car nous ne sommes ni impatients, ni fous, mais notre attention s’accroche à des détails, à des preuves qui prouvent beaucoup. Et nous savons fort bien comment le monde tourne.
Bonsoir mon moineau. Tu as beaucoup volé dans ton ciel aujourd’hui. Viens nicher contre mon épaule. Elle est si pleine de secrets qu’il faudra picorer toute la nuit. J’ai des histoires extraordinaires à te raconter sans relâche, où tout est si beau, que le cœur s’arrête de battre. Il faut savoir être si gentil que les oiseaux viennent dans votre main, et que les anges ne s’envolent pas. Et si tus es très mignonne, comme tu sais l’être quand tu réponds « oui sans condition », on te regardera dormir, au matin.
Chez Fayard ce n’est pas le n°49 mais 219 qui correspond au théâtre d’Eschyle demandé. Si tu ne le trouves pas à la maison mère, tu dois l’avoir sous les arcades de l’Odéon, ou chez un libraire bien assorti.
Tu viens me voir jeudi 5 mai [1], sans compter tous les soirs bien entendu. Bonsoir. Je sais que tu es plus gentille et plus sage que tout. Et je t’embrasse d’autant plus que tu ne t’es jamais ennuyée, que tu ne t’ennuies jamais ; et que tu travailles à être bonne un printemps tout entier.
Dimanche de Pentecôte.
As-tu été à la campagne ? Moi, oui. Je me suis baladé dans un immense paysage toute la journée. Dès le matin la lumière était si précise qu’elle accusait tous les détails jusqu’au fond de la plaine. Après déjeuner sous le soleil brûlant nous pûmes nous promener en liberté entre quatre murs qui n’existaient que dans mon imagination, avec de délicieux camarades qui s’appellent Cousteau, Rebatet, tous les ministres et autres journalistes plus ou moins condamnés à mort d’hier ou de demain. À propos, un brave policier Moershell dont le dossier était beaucoup plus chargé que le mien et qui s’attendait aux « chaînes » vient d’être condamné à perpète seulement. Il y a peut-être détente. On en voit un autre signe dans le fait que malgré les démentis, le maréchal regagne sa maison de campagne de Villeneuve-Loubet [2]. Et puis nos camarades enchaînés sont toujours là. C’est aussi un signe car, si parmi eux il y a de noires fripouilles, il y a aussi d’honnêtes gens. Il y en a un qui est condamné depuis plus d’un an !!! Je crois qu’il aura subi un certain calvaire. Un an à se préparer tous les matins, à ne plus savoir s’il doit espérer ou se résigner.
Donc, tu ne viendras que mardi. Je ne sentirai point demain matin tes baisers sur mes barreaux, et je ne regarderai pas par ma fenêtre pour voir au loin une silhouette ne sachant si c’est toi ou un ouvrier plâtrier, ou un sergent de ville. Quelque chose bouge sur la route qui pourrait être tout le meilleur de ce que j’aime. Car tu es le meilleur de ce que j’aime puisque j’ai construit sur toi ma part humaine de grand bonheur. Je m’appuie sur ton cœur comme une source vivante parce qu’il me fut indiqué que je pouvais et qu’il fallait t’aimer comme tu étais avec tous les infinis que cela suppose. Ce que j’ai vu en toi me récompense de toutes mes recherches. Tu es la femme qu’on estime comme étant la plus chère à garder mon amour intact à l’abri de toutes les épreuves. Tu ne dis rien, petite sauvage, mais tes yeux parlent trop. Et puis je te sens, je t’écoute penser. Et tes œillets, tes pivoines, tes tulipes m’ont avoué des choses extraordinaires. Et je te permets de m’aimer comme je suis, avec la joie que cela te donne, et que tu me donnes. Ce sont des choses que je n’ai jamais permises à personne. Je crois bien que c’est la première fois que j’ai cassé ma méfiance contre une partie de la route. Tes pâquerettes durent encore. Ce que c’est que mettre toutes ses tendresses dans l’eau fraîche.
Bonsoir pour ce dimanche. Demain aura tout le bas de cette page, pour te dire ce que je pense lundi. Je sais déjà ce qu’il aura vécu de bonheur à te sentir vivre. Le Frédéric aura du te combler avec sa vie triomphante. Notre Frédéric est un dieu. Adore-le. Soigne-le. Embrasse-le comme un dieu. Non point un petit dieu personnel, un tyran domestique, mais le bonheur et la douceur elle-même. Il a toutes les qualités et point de défauts du tout. Je bénis comme toi sa perfection. Bonsoir moineau. Ton cœur bat trop vite si tu n’es pas sage. Arrête-le et tu m’entendras dire tout ce qu’on raconte de toi dans le meilleur des mondes. Je te chéris au plus au point.
Lundi de Pentecôte, 13 heures.
Temps orageux, bonne chaleur. Nous avons tourné en cage toute la matinée entre intellectuels patients, tous souriant des menues épreuves de l’époque, tous habitués à franchir toutes les passes pessimistes, tous munis d’un éternel printemps qui ne tient pas compte des révolutions, des tortionnaires et des bourreaux. As-tu lu les chiffres donnés par monsieur Mitterand [3] à la tribune de la Chambre sur les morts de 39 et 45 : 97.000 « victimes civiles diverses » (!!!) ne sont ni déportées, ni bombardées, ni fusillées, mais apparaissent dans une liste déjà suspecte et incontrôlable comme une masse de Français jetés à terre par des fanatiques de la liberté). Dans les 150.000 « déportés résistants » on doit calculer au moins 100.000 juifs, plus les ouvriers français morts en Allemagne. Menthon, à Nuremberg, avait donné 40.000 morts dans les camps. Il faudrait expliquer cela. De même sur les 57.000 FFI tués, la plupart sont des soldats de l’armée Juin, formée par Vichy grâce à Weygand qui fut engagée par De Gaulle en Italie et se fit quasi intégralement massacrer. Les « vichystes » n’ont pas de chance. Voilà que c’est moi qui te donne les nouvelles. Les condamnés à mort attendront jusqu’au 15 juin pour voir examiner leurs dossiers. On recule. On temporise. On espère. Ramadier n’est pas content. Et le populo encore moins. La vie devient intenable. Sous un gouvernement d’imbéciles, les honnêtes gens se décident à s’agiter. Confusément encore, la nation sent qu’on a fait sur son dos une opération de gang. Il faut travailler à la réveiller.
Ceci dit, qui ne t’intéresse point (car égoïste), tu ne penses qu’à ton amour, et les secrets du cœur, et la joie que tu auras quand nous irons tous les deux dans les concerts ou les théâtres écouter le Wagner ou le Beethoven ou le Bach qui est le meilleur souffle de l’humain inspiré, quand je prendrai ta main de fillette pour t’amener au Louvre ou à Bruxelles, ou à Anvers, ou aux offices, ou à Rome, ou à Memphis, ou à Athènes, regarder les pierres, et les fresques, et les toiles, et les vierges nimbées d’or sur les fonds de richesse infinie, quand je te ferai épeler mot à mot les vers de cristal et de pierreries, et de rosée, et de douceur qu’un poète tira du plus haut de sa piété quand il buvait la lumière intime d’un crépuscule humain, quand il entrait dans un paradis nouvellement éprouvé. Nous marcherons dans des paysages de verdure et d’extase plus pure, et je connais de hautes montagnes où le cœur devient si large qu’il acquiert sa dimension infinie à force de s’accrocher à des cimes et des lumières lointaines. Je cueillerai pour toi les fraises des bois, les papillons dorés, les mûres gonflées d’ardeur. Je t’apporterai les grillons et les sauterelles aux ailes lucides et je t’expliquerai le chant des étoiles quand la nuit commence à étouffer le cri des choses. Nous aurons bavardé avec des tas d’animaux, créatures sublimes et simples qui repoussent toutes les complications de la ville. Nous aurons appris le mystère des feuilles, et des lobes, et des calices, et des pollens. Par la couleur du nuage au soleil couchant, nous saurons comment prier pour que l’orage du lendemain soit la meilleure leçon d’attente, et le torrent sera moins fort que le flot de nos pensées heureuses, à regarder les gouttes de pluie s’accrocher aux sapins stoïques. Un monde s’ouvre dans lequel il faudra avancer à pas prudents, sans blesser les fleurs du gazon. Nous avons droit à suivre le sentier sévère qui conduit au chalet de repos. Et de là, la course si utile ne frôle que des apothéoses.
Je suis certain de terminer un petit recueil de portraits qui me déplaisait à écrire parce que violemment, et nécessairement, acerbe. Il faut fustiger le monde pour s’en détourner. Mais la série trop longue de ces pantins épuiserait le lecteur. Je conclus donc positivement en tournant la page et en scellant ce livre de chair d’un voile de douceur et d’espoir vers d’autres cieux. Immédiatement après j’ai l’idée d’écrire un court volume sur une théorie de l’art tel que je le conçois. Sujet emballant. J’en ai pour un mois environ. Pas touché à Gabriella qui n’a subi que quelques retouches. J’attends d’avoir conçu, reçu, exprimé mon traité de l’art pour commencer une nouvelle œuvre car, faut-il s’imposer quelques limites et ne pas céder au seul instinct.
Aujourd’hui, jour férié, pas de réception de courrier. Donc je ne te lirai point car j’imagine qu’une, ou plusieurs lettre sont en route. Que Frédéric m’a-t-il écrit cette semaine ? Il faut considérer les enfants comme de merveilleux professeurs de pureté. Je suis sûr que ton fils doit t’apprendre des tas de choses que tu avais oubliées, car tu savais tellement mieux, quant tu étais toute petite que la vie est si belle qu’on ne peut que s’émerveiller. Je t’aime. Je t’embrasse. Je crois en toi. J’attends tes lettres. Je te dis « oui sans conditions ».
J.
[1] Probablement erreur de mois (jeudi 5 juin ???).(note de FGR)
[2] Rumeur erronée : Philippe Pétain fut emprisonné au fort du Portalet, dans les Pyrénées, du 15 août au 16 novembre 1945, puis transféré au fort de la Citadelle sur L’Île-d’Yeu (Vendée). La santé du maréchal Pétain déclinant à partir du début de l’année 1951 et ses moments de lucidité devenant de plus en plus rares, le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par Vincent Auriol, président de la République, autorise le 8 juin 1951 « l’élargissement » du prisonnier et son assignation à résidence « dans un établissement hospitalier ou tout autre lieu pouvant avoir ce caractère ». Le transfert dans une maison privée de Port-Joinville a lieu le 29 juin 1951, où Philippe Pétain meurt le 23 juillet 1951. Il est inhumé le surlendemain dans le cimetière marin de l’île d’Yeu. (note de FGR)
[3] François Mitterrand est ministre des Anciens combattants et victimes de guerre dans le gouvernement Ramadier en 1947. (note de FGR)