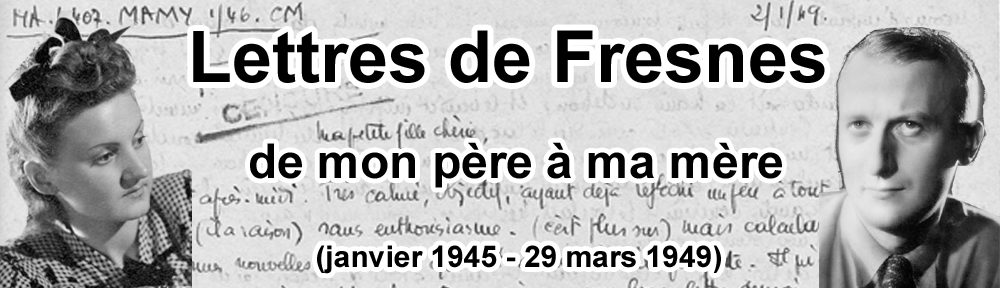Dimanche 3 novembre 1946
Ma chérie,
J’ai aujourd’hui travaillé comme un Dieu. Enfin, je vois clair dans un petit travail entrepris. Il m’a fallu huit jours assidus pour mettre au point quelques notes et je vais pouvoir repartir du pied droit dans un nouveau travail (important comme toujours). Tout est important de ce qu’on écrit dans ces conditions. Nous n’avons plus de temps à perdre nous autres si nous voulons laisser à la postérité —qui jugera— quelque chose de cohérent. Les années passent si vite : on n’a si peu d’occasions d’écrire calmement. Utilisons à fond les jours que nous avons devant nous.
Inutile de te dire que je n’ai pas flanqué le nez dans mon dossier. J’ai pourtant une note à rédiger. Je la commencerai demain car j’ai l’impression qu’on m’appellera cette semaine. Nous mettrons beaucoup de choses au point. Attendons avec patience le résultat des prochaines élections. Et la situation internationale. Tous les matins, les prisonniers interrogent l’horizon politique. Toujours rien ? Pas de changement ? Que les hommes sont lents à se décider au bien !
Ainsi, tu ne m’as point écrit du tout cette semaine ! Que des mots griffonnés en hâte, quand j’avais besoin de longues explications précises. Que se passe-t-il ? Aurais-tu tant de travail que tu ne trouves plus le temps d’écrire ? Ou bien si peu de choses à raconter ? Paresseuse ! Je t’écris toutes les semaines un roman et tu me réponds par trois bouts de lignes bourrées de caresses rapides. Où volète-elle cette Jeannette ? Pourquoi ne prend-elle pas le temps qu’il faut de se poser précisément là, pendant une heure, à regarder la vie s’écouler et comprendre le flot, les myriades de sentiments qui s’entrecroisent à propos de tout et de rien, où Jean doit probablement être mêlé, avec des présences qui sont supérieures à l’absence. Il faut oser respirer son amour, le vivre, le savourer, s’endormir avec, le penser, en remâcher la substance, sans quoi ce n’est qu’un nuage au vent.
Le ciel était si bleu et rose ce soir, si triste et grand, plein de mystères comme les vieilles chansons européennes. Où sont-ils les trouvères qui célébraient les anciens mythes, ces géants qui portaient en eux des histoires prodigieuses, si riches de récits de batailles, de prières, de hurlements sauvages contre la terre, de paix en s’endormant sur le ciel tout chargé d’astres purs ? À voir ce ciel boursouflé, étiré, parsemé de longues trainées indigo, on croirait vivre dans des rôles d’antan, des songes de fées où les mortes princesses s’étalent langoureusement sur les crépuscules pour laisser le parfum de leur souvenir. Si dans une boîte des quais tu trouves un […beleurgen…][1] pas cher, envoie le moi. Je relirai les vieux chants du Rhin.
Et, pour ce soir, je vais t’endormir patiemment avec des fleurs tièdes, des mots fanés, de lentes précisions. Les clés tournent dans les serrures ici, avec des bruits barbares. Les heures sonnent, sèches, sans grâce, des heures de prison en uniforme. Mais nos pensées traversent l’ironie ou la douleur des choses et réconforte celui qui marche vers son destin. Patience, lenteur, confiance. Toutes les récompenses sont au bout de la route même si elle est longue. L’homme ne meurt jamais tant qu’il a conscience de la lumière, à travers tous les obstacles de matière. Je sais que tu sais cela si bien qu’il est inutile de souffler des mots qui pourraient déranger tes pensées sauvages. À demain. Ferme les yeux. On t’embrasse. Tu as dû mettre de l’amour toute la journée en petits paquets. Et on t’aime bien, beaucoup, très beaucoup.
Lundi matin.
On t’aime beaucoup plus encore en se réveillant qu’en s’endormant, car je te tiens mieux dans ma pensée active que dans mon sommeil. Tu y apparais plus vivante, plus réelle, non point avec des souvenirs, mais comme une présence en mouvement. Je ne t’imagine pas. Je te sens vivre ! Et ce contact est la permanence notre accord. Je sais que tu penses de même, que les arbres que tu vois, la liberté où tu vis, ne sont que le reflet de celle où j’évolue. Même liberté en deçà et au-delà des barreaux qui ne sont que symbole de pauvre heure tôt effacée. Qu’est-ce qui semble nous séparer ? Une opinion publique. Félidé ! Il n’y a pas de brouillard pour les yeux vifs. Tout se dissipera bientôt. Il faut beaucoup de patience et de fermeté.
J’ai encore sous les yeux tes œillets de la semaine dernière. Le froid les a fait durer. Pas du tout fané, aussi frais qu’un sourire du premier jour. Est ce que le froid conserve aussi tes yeux clairs ? Et ton souvenir du premier jour ? Est-ce que vraiment cela t’a fâché que je t’ai cassé une boucle de ceinture ? Est-ce que tu égrènes tes souvenirs comme un chapelet ? Est-ce que la masse de jours heureux qui nous attend n’est pas plus importante que tout ce que nous laissons derrière nous. Il ne faut jamais regarder en arrière. Jamais tenter de retrouver quelque chose. Tout ce qui est passé est une construction dans quoi on peut vivre à condition de ne pas la laisser manger par la poussière, le chagrin, le désespoir, toutes ces petites maladies sans réalité. Rien ne peut empêcher un homme d’accomplir son destin. Si je dois être ce que je suis, même la mort ne saurait s’interposer entre la vie et moi. Il me semble souvent que j’ai déjà franchi la barrière. Peut-être plusieurs fois. Que l’existence humaine peut être comparée à la feuille d’un arbre. La feuille tombe. L’arbre reste. Et quand celui-ci meurt, une graine en reproduit l’espèce. Et quand celle-ci s’éteint, c’est parce que le monde à qui elle appartient cède la place à un autre plus vigoureux. Ainsi de suite. L’homme se perpétue, se transmet, hors des formes. Bien plus, il n’existe qu’en dehors d’elle. Il ne faut pas qu’il soit atteint par le sens de l’éphémère. C’est là où il s’agite dans l’angoisse. La sérénité exige de nous d’être éternels. Que rien au monde ne trouble cette magnifique lumière qui ne saurait venir que d’un esprit impérissable. Et c’est là, où je n’entends plus les chaînes des condamnés à mort, comme les hurlements de la foule, où les pleurnicheries des prétendues victimes, qui, furieuse de leur impuissance, prétendent déchirer le ciel avec leur ongles.
On t’aime beaucoup. On t’embrasse. On te félicite de n’avoir pas écrit, mais d’avoir dit tant de choses entre les lignes désirées. Et on pense à toi, en imaginant que nos petits doigts se sont accrochés pour une longue promenade sur les feuilles sèches des forêts d’automne. Et nous avons couru tout le brouillard d’hier, tout le calme mystérieux de la nuit, tout le repos du matin. Et j’ai bu tes larmes de joie, sous les branches dénudées d’un grand chêne qui tendait au ciel triste une sorte de chevelure de métal, rigide comme une harpie, figé dans son héroïsme inutile.
Téléphone à ma mère au sujet de couverture et robe de chambre. J’ai oublié de lui en parler jeudi. Je pense que tu pourrais venir jeudi en huit. J’arrange tout pour cela. Viens seule. Frédéric est charmant mais je préfère te parler précisément sur beaucoup de points.
18h.
Je viens de passer une heure à déballer le colis qu’avait préparé la fée blonde que je connais, et les trois œillets ont pris leur place avec les autres. Ils font bon ménage, les mimosas aussi s’entendent bien. À la minute je reçois ton mot très court de samedi. Ah ! Tu penses à moi entre toutes les pages. Eh bien moi, c’est entre toutes les lignes que je pense à toi, entre toutes les lettres, et à travers le papier. Voilà. Si l’on veut faire un match entre qui de nous deux pense plus à l’autre, tu ne gagnerais peut-être pas. Il est vrai, pour ton excuse, que j’ai plus de temps que toi. En apparence seulement !…
J’ai réussi à rédiger la note pour le juge. 10 pages qui sont prêtes. Dis-le à Flo. ou plutôt à ses subordonnés que je la leur remettrai à la prochaine visite. Tu la taperas rapidement. Puis ils la remettront officiellement quelques jours plus tard. Et tout sera peut-être terminé. À moins qu’on m’interroge encore sur cette note, ce qui est possible, car elle contient un certain nombre de détails nouveaux. Il faut encore que je voie ou Demeury ou Liebmann pour prendre avec eux certaines dispositions relatives à la rédaction de ladite note. Téléphone-leur qu’ils n’oublient pas de me faire appeler à la prochaine visite. Merci pour tout. Les clous, etc… Tout va très bien. Le colis est parfait, parfait.
Alors, tu y crois, toi, à la détente ? On n’en parle toujours ici comme si on espérait en la bonté des hommes. C’est bien difficile, quand de tout temps on a reçu des coups, d’imaginer que tout à coup ceux qui étaient hier vos détracteurs pourraient se comporter en amis. Il est surtout beaucoup plus difficile à imaginer que tout à coup l’égoïsme du monde a cédé, et que ceux qui se recommandaient le plus de la fraternité finissent par éprouver l’attrait des mots et mettre en pratique les principes qu’ils profèrent. À propos de la tache que voilà, veux-tu bien me mettre quelques buvards qui boivent l’encre. Les miens sont fatigués au point de se refuser à tout travail. Il me reste trois lignes pour t’embrasser comme je le voudrais. Une pour te mettre le bras autour de la taille, une autre demi-ligne pour te regarder si longtemps dans les yeux que tu en ferme les paupières de peur d’être brûlée par une flamme trop vive, une ligne pour mettre mes doigts dans tes cheveux et les fourailler en les caressant, une ligne très courte pour t’enlever les boucles d’oreilles qui me plaisent et la dernière pour te dire ce qu’on ne dit pas. Gros, gros, comme tu dis. Bonsoir, bonne nuit.
J.
[1] Mot illisible (note de FGR)