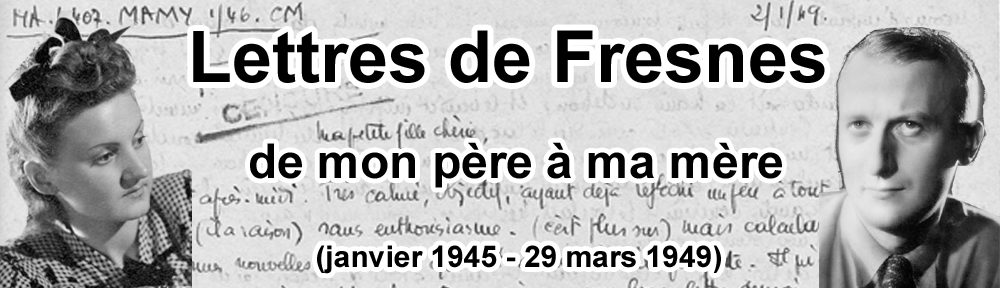Dimanche 12 janvier 1947
MaJeannette chérie,
Bien reçu ton mot enthousiaste, mais pas plus de visites de Liebermann que de Demery. J’aurais bien voulu que mes avocats m’apportent un peu de nouvelles. Voilà près de trois semaines, et même plus, que j’attends ledit Liebermann. Téléphone-lui et dis-lui qu’il ne manque pas de m’appeler. On ne me fera pas croire que la maison Floriot n’est pas venue à Fresnes cette semaine. J’ai des tas de choses à lui donner pour le dossier. Je sèche, moi. C’est la moindre des choses qu’il m’avertisse de ce qui se passe.
Et puisque voilà ma mauvaise humeur calmée, je vais immédiatement féliciter de ta joie. Elle doit être parfaite pour m’avoir envoyé d’aussi bons vœux d’espoir. J’en accepte l’augure. Tu me diras jeudi au parloir ce qu’il en est, car c’est toi qui viens. Arrange-toi avec ma mère. Je veux te voir. Pas d’histoire. Et viens seule, ou avec Frédéric, comme tu voudras. Si tu as beaucoup de choses à me dire, viens seule, sinon, montre-moi le gros garçon que je n’ai pas vu depuis longtemps.
Moi, de toute façon, j’ai beaucoup de choses à te dire. Mais le grillage m’empêche de dire tout. Alors il faut se dépêcher de sortir et pour ce, faut-il activer ou retarder ? On ne sait. Qui le sait ? Je commence à trouver le temps propice pour une promenade en forêt. Sais-tu —tu le sais— que dans moins de deux mois, je fêterai mes deux ans de Fresnes. Deux ans et demi d’emprisonnement ! Et ce n’est pas fini. Il faut encore compter sur ses doigts les mois et peut-être les années à venir. Je dis cela, mais dans le fond, j’espère le contraire. Est-ce qu’il y a un coin de la terre où les hommes aient le cœur juste, sinon généreux. Il est vrai qu’on ne peut attendre de la générosité des injustes.
Donc j’ai encore beaucoup de choses à te dire. Car je n’ai encore rien dit. De ce que je pensais au fond et qui constitue le meilleur de tout. Tu n’as recueilli que quelques pétales jetés hâtivement car il fallait bien épancher le trop-plein et donner les fleurs naissantes pour ne pas les voir faner sur tige. Mais la sève de l’arbre est si vigoureuse qu’elle contient de magnifiques floraisons qui promettent des fruits succulents. Il faut attendre l’été, l’été de la tendresse. À mûrir lentement, ils ne seront que plus doux. Et tu sais attendre, petite camarade. Mets ta main dans la mienne et pour une fois ne soit ni effarouchée ni inquiète.
Mon moineau, tu ne m’écris pas beaucoup, pas longtemps, tout juste ce qu’il faut pour que je ne te gronde pas. Je sais bien que le Frédéric doit prendre tes journées, qu’il te grimpe un peu trop sur les épaules, et te tire le bras quand tu prends la plume, mais si j’exigeai de toi un journal quotidien très serré comme le mien et fabriqué de façon telle que toute ma semaine soit remplie de tes souvenirs ou des récits !!! En as-tu de la chance d’être dehors pour voir tous les films et toutes les pièces de théâtre, et la figure de tous les fameux politiciens du jour. Ce doit être magnifique d’admirer les grands personnages de la IVème République de près. Avoir touché le veston d’Untel, frôlé la moustache de l’autre, quelle grande époque.
Tes tulipes tiennent encore et les œillets sont aussi frais que le premier jour. Et demain, je remonterai du colis un nouveau bouquet. Jusques à quand, mamzelle, allez-vous ainsi m’entretenir comme ce prophète de la Bible à qui les corbeaux venaient apporter la becquée dans le désert. Mon moineau est plus joli. Il n’a pas moins de cœur que les oiseaux consacrés. Tous les cadeaux vous viennent du ciel. J’imagine que tu as dû passer une heure au moins avec ma mère aujourd’hui pour lui apporter tes petits paquets. Et vous avez dû vous réjouir ensemble d’espérances et de certitudes.
La seule idée possible de sortir un jour et de reprendre une activité publique ou privée m’as secoué la torpeur dont j’étais accablé depuis longtemps. On se fait lentement à l’idée d’être fusillé. On a à cœur d’écrire le plus vite possible les meilleurs choses dont on était capable, regrettant de ne pouvoir tout dire, et surtout craignant que le plus haut de soi-même soit perdu, parce qu’incompris ou égaré. Déjà, les FFI m’ont déchiré un très précieux poème où j’avais quelques chansons assez pures. Je n’y tenais pas tellement. C’était une esquisse curieuse. Il est vrai que j’ai fait mieux depuis. On n’en a fini avec ce monde, avec la vie, avec les amis, on n’espère pas au-delà de la mort, on vit pour l’image qu’on laissera, et puis tout à coup déception ! On vient vous dire qu’un jour il faudra revenir dans cette sacrée existence avec laquelle on avait rompu, reprendre un collier de travail pénible, avec en face de soi les habituels mufles que cette civilisation mécanicienne a fabriqués pour le malheur des poètes. Ainsi tu crois que ma modeste existence ne finira pas un matin à Châtillon ou Gennevilliers et qu’il va falloir dans deux ou trois ans (?) Remettre ça ! Heureusement que tu seras là pour me cacher toutes les laideurs de la vie. Sais-tu bien quelle responsabilité tu prends ! Énorme ! Mamzelle. Tâche titanesque.
Je crois au fond qu’il suffira de ta main sur mon front et d’un souffle tendre pour que tout s’apaise. C’est le seul espoir de la France de renaître, que les femmes prennent les hommes par la main et les empêchent de se battre. S’il n’y a pas une association puissante de pacifistes femelles qui s’oppose à ce que les extrêmes se rencontrent, nous n’y couperons pas d’un choc géant. Car si tu t’imagines que nous avons oublié la moindre des choses qui fut faite contre ce pays. Jusqu’à présent j’ai relu de douces choses ici, Racine et Baudelaire, Musset et Villon, Musset et Valéry. Mais il y a un Corneille qui dort à la bibliothèque et je compte bien reprendre le texte d’Horace et celui du Cid pour m’en imprégner de mâle ardeur. Ce sera comme un sang nouveau dans des veines nobles, préparé pour recevoir le feu d’une pensée vive. Je n’ai pas fini d’œuvrer.
Alors tu crois comme ça que les choses vont finir par s’arranger pour moi. Et tu t’en réjouis ! Tu sais que la vie ne sera pas facile à mes côtés. Si tu veux vivre tranquillement, laisse-moi le plus longtemps possible en prison. Je ne me sens pas du tout disposé à vivre dans mes pantoufles et à cultiver mon jardin.
Lundi 13h.
Ma lumière s’est éteinte hier soir en pleine lettre, et j’ai dû profiter d’un restant de bougie pour faire ce que j’appelle pompeusement mon lit. Ma paillasse est arrivée au point de la parfaite rigidité, si bien qu’il m’est agréable de me réveiller quelques fois par nuit pour me retourner comme une crêpe que le feu doit rôtir alternativement de chaque côté. J’ai lu avec attention ton offre aimable de m’envoyer un petit oreiller de duvet. J’avoue que cela me travaille l’esprit. Est-ce que tu crois que c’est chrétien de coucher dans du mou ? Mon polochon est une sorte d’amas de crin et de matière paillue, sur quoi je pose le coussin kapok, semi rigide, dont tu m’as fourni l’enveloppe. Mais si tu m’envoies de la plume pour ma tête !!! J’ai peur de faire des rêves ! À consulter une tulipe qui s’ouvre sous mon nez, j’hésite encore. Faut-il vraiment accepter cette douceur si féminine ? J’ai peur de m’attendrir. D’autant plus que je relis le Pèlerinage aux Sources [1] de Del Vayo où les méthodes yogis les plus dures sont recommandées pour l’éveil de la spiritualité. ! Voilà que je commençais à essayer la pause dite « en fleur de lotus », les pieds couchés sous le buste, la plante en l’air, les bras croisés dans le dos tenant le gros orteil adverse par une sorte d’emmêlement qui fait de l’homme un véritable nœud gordien. Au bout de deux heures d’exercice quotidien, on en sort moulu, amaigri, purifié, plus lavé qu’au hammam. Et voici que tu me proposes le mol oreiller de jouissances occidentales, à moi qui me suis refait une virginité à force d’épouser la raideur du plancher. Déjà je trouvais que la peau de mouton était un luxe !
Envoie le moi tout de même l’oreiller. S’il me semble impie, je le retournerai avec des mots sévères.
Si je t’embrasse, c’est moins pour le plaisir que pour la joie, moins pour ta bouche que pour ta tendresse, moins pour t’étreindre que pour t’épouser. Si je suis heureux de la flamme qui court tes yeux, c’est qu’elle vient du ciel, et qu’elle embrase tout l’instant. Tu sais que j’ai tellement souffert de toutes les oies que j’ai rencontrées (sans parler des grues, des perruches, des dindes, des corneilles et des harpies) que j’avais résolu de m’isoler désormais dans le mépris total de ce qu’on appelle Sa Majesté la Femme. Tu es la seule qui aie trouvé le moyen de me faire changer de route. Cela tient, je crois, à une seule chose : tu ne t’enorgueilleras pas de ce secret (Attention ! Tant pis pour toi) : tu as osé persévérer ! Tu as continué à combattre silencieusement toute l’opposition qui grondait en moi et qui ne s’adressait pas à toi mais à l’image que je me faisais de la femme en général. Tu t’es montrée soumise, dévouée, fidèle. Tu t’es accrochée. Et puis tu as eu depuis que tu es mère une attitude épatante. Tu t’es montrée désintéressée. Tu as gagné. La porte est ouverte. Il ne fallait qu’une chose pour déclencher mon affection confiante : l’estime. Tu l’as. Tu es mon moineau.
20h.
Tu es de plus en plus mon moineau. Tes œillets (ceux de cette semaine et ceux de l’autre) sont tous regroupés dans la même gerbe. Les chiffons de paresse tendre en papier sulfuré sentent bon le cœur de Jeannette. Tu as mis tout ce qu’il me fallait pour vivre huit jours heureux dans ton bouquet précieux. Et je vais vivre des heures patientes, en noircissant du papier. J’ai pensé la nuit dernière un nouvel ouvrage. Sais-tu que j’ai devant moi au moins cinq pièces et quatre romans à écrire, plus un bouquin de philosophie. Et je ne compte pas les vers. Tu peux acheter trois machines de rechange. On t’embrasse une fois, deux fois, trois fois, dix fois, cent fois. Très sérieusement. Tu n’imagines pas à quel point c’est sérieux. Je mets très longtemps à m’attacher, mais… Bonsoir
J.
PS. Fais rire le Frédéric pour moi.
[1] Livre de Lanza del Vasto, et non del Vayo, (1901-1981), philosophe, poète et militant de la paix italien, publié en 1943 où il raconte son premier voyage en Inde (note de FGR)