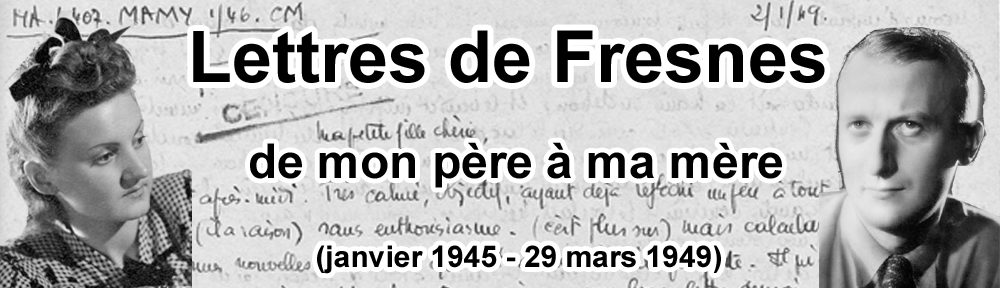Dimanche 17 août 1947
Ma chérie,
 Il fait chaud, chaud, très chaud. On se demande pourquoi. On se demande toujours quelque chose. Les pourquoi sont des aveux d’impuissance. C’est comme ça. Et puis, au fond, il ne fait pas si chaud. On pourrait encore supporter bien davantage. En voulez-vous des zhomards [1] ? Nous sommes en plein hammam. Ma cellule est tamisée par un tulle anti-moustiques. Moins d’air, mais on peu enfin dormir. On s’organise.
Il fait chaud, chaud, très chaud. On se demande pourquoi. On se demande toujours quelque chose. Les pourquoi sont des aveux d’impuissance. C’est comme ça. Et puis, au fond, il ne fait pas si chaud. On pourrait encore supporter bien davantage. En voulez-vous des zhomards [1] ? Nous sommes en plein hammam. Ma cellule est tamisée par un tulle anti-moustiques. Moins d’air, mais on peu enfin dormir. On s’organise.
Toujours pas de nouvelles. Je crois que nous n’en n’aurons pas avant un mois au moins. J’ai du reste l’intention de faire une dernière démarche pour obtenir une mise au point supplémentaire. Je pense qu’on me l’accordera. Sinon nous jouerons la partie. J’ai depuis peu de temps un atout important. Je l’avais déjà mais il n’était pas utilisable. Nous pourrons sans doute maintenant mieux nous défendre. Ce qui ne veut pas dire qu’on réussira à amadouer un jury bougon. Mais, sera-t-il bougon ? Et puis, attendons. On verra bien ce qui se passe.
J’ai bien reçu toutes tes lettres si gentilles, si complètes, si nourries de toute la campagne et de tout Frédéric, et de tout ton cœur de mère et d’amante, et d’épouse, et d’amie. Grossis énormément. Il faut me tenir compagnie. Tu vois comme tu es négligente. Je n’ai plus d’autre papier. Celui-ci boit terriblement. C’est qu’il est trop tendre. Il s’émeut à la seule idée que je t’écris.
Bien sûr, je t’attends le jeudi 11. Encore 3 jeudis sans te voir. Bigre ! Surtout n’écourte pas tes vacances. Reste bien tranquille avec Frédéric. Et surtout buvez du grand air à pouvoir s’en rappeler toute la vie. Quoique, si nous allons en Argentine, il connaîtra la Pampa et la Cordillère des Andes.
J’ai beaucoup travaillé depuis huit jours. À des choses pas drôles du tout, mais si réjouissantes. Gros effort pour sortir de la condition où nous paraissons être. Nous y arriverons. Il y a des miracles qui se font attendre. C’est qu’ils seront d’autant plus réussis. Tu sais que je t’aime beaucoup. Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu le sens ? Tu es devenue petite campagnarde lointaine. La Creuse t’a grisée. Tu as déjà tout oublié. Voilà ce que c’est que rêver de vaches et de cochons. On se laisse bercer par la nature trop séduisante. Et l’on oublie sa grande ville et son prisonnier. Prisonnier si libre, car il chante sans rien en dire à personne. Si haut qu’on ne l’entend plus.
J’espère que tu fais des photos !!! Et beaucoup. Moi, il faut des images du Bon Dieu, le Frédéric sur toutes ses faces. Avec toutes ses dents, et cheveux au vent.
Les évènements ont l’air calmes, comme ça depuis 15 jours, et puis on apprend pas mal de petites choses curieuses. On te racontera ça au parloir. J’imagine que les gens qui ont en mains les destinées glorieuses de la vieille carcasse gouvernementale ne doivent point se sentir très à l’aise. Il semble que les difficultés soient plutôt nombreuses. Je ne m’en réjouis point. Je ne m’en afflige point non plus. Si tu savais comme on se durcit d’un certain côté pour ne plus s’attendrir que pour ce qui en vaut la peine. Sur Jeannette par exemple. Elle est si gentille. Elle a tant de qualités magnifiques. Je ne cesse de les recompter.
Je vais t’embrasser pour ce soir, et me plonger dans des études métaphysiques. J’ai encore beaucoup à faire avant que la lumière s’éteigne ou que le sommeil me prenne. Généralement je tombe comme une masse, sans avoir le courage de relire une ligne de plus. Ce soir il me faut finir au moins la valeur de trois chapitres de Bible et piocher des textes ardus. Bonsoir fille aux cheveux doux. On vous laisse dormir comme un ange du ciel. Et encore, ceux-là veillent tout le temps.
Lundi 9 heures.
Fort bien dormi. Quoique très tard et réveillé très tôt. Ai bougrement pensé à toi. Pourquoi ? Parce que. Il me semble que si tu habitais la cellule, on ferait bon ménage. Tu coudrais sure le divan (pas très rembourré, le sommier est plutôt curieux) pendant que j’écrirais. Et l’on passerait les journées à ne rien se dire, en se disant tout, ou à tout se dire, en faisant des riens, des riens qui sont tout. Tout ou rien.
Si j’avais su partir en Argentine depuis l’enfance, je me serai occupé du dressage des chevaux. Tu me vois galopant vers toi du fond de la plaine, Ô maîtresse de l’hacienda, entourée de tous tes garçons. Et tous tes garçons iraient à cheval, en tirant en l’air des coups de feu, avec des airs de Peaux-Rouges.
Et l’on viendrait en chœur, père et fils, déposer à tes genoux les plus belles brassées de fleurs de la plaine. Nous aurions de merveilleux papillons dans nos étuis précieux, des scarabées dans toutes les poches, des fruits exquis dans nos besaces, et des moutons fraîchement écorchés sur les épaules. On flamberait l’animal tout entier pour le repas de midi, et l’on repartirait jusqu’au soir pour l’abattage des arbres et la chasse au puma dont tu aurais trente peaux dans l’immense chambre qui serait ton palais intime, toute entière tapissée des plus merveilleuses fourrures des bêtes de la jungle andaise. De vieux Incas seraient tes domestiques si dévoués que tu n’aurais plus souci que de boire l’air bleu, respirer toutes les roses du jardin et regarder les vautours tournoyer le long des flancs de l’immense montagne. Et je t’aurai rapporté de la ville une Bible neuve, dorée, et petite, écrite menu, mais précis, où tu aurais intercalé des fleurs séchées.
12 heures.
Je reçois ta lettre de mercredi à l’instant. Elle tombe comme un dessert après un déjeuner frugal. J’ai vu que dans le colis nombre de petits paquets étaient encore numérotés par toi. Tu as sans doute préparé plusieurs colis d’avance. Prévoyance ! Exquise attention ! Tu es une fée. Alors, on s’inquiète de savoir pourquoi le papa ne prend pas ses vacances en même temps que les trois dames. Et pourquoi la colonelle fait du vélo. Peuple de moucherons ! Cirons [2] ! Fourmis ! Sauterelles ! Insectes bafouilleux ! Les gens ne savent que papoter. Il faut qu’ils se mangent entre eux à tous propos. Si tu n’étais pas là, et si je n’avais conscience que nous pouvons faire ensemble un bout de chemin utile, je serai ravi d’être condamné à mort et exécuté. Pourquoi veux-tu vivre avec ces crapauds ? Je crois qu’il faut très vite quitter la Terre et toutes ces bêtises. On commence à en avoir assez des stupidités crasses.
Je ne dis pas tout cela parce que je sens s’avancer contre moi l’heure d’une échéance dure. J’écris aujourd’hui à Flo[riot] pour lui demander de venir me voir ou de m’envoyer quelqu’un. Les rôles d’octobre sont en train de se constituer. Il ne faut pas que nous y figurions. J’ai une chose très importante à déclarer et il faut obtenir une séance d’instruction supplémentaire. C’est indispensable à tous points de vue. J’ai de nouveaux témoins à produire qui changent complètement la face du procès (ou, sinon complètement, tout au moins apportent les lumières que je réclame depuis deux ans ½, et qu’on ne m’a pas encore laissé le droit d’allumer). Je compte donc sur toi pour me prévenir dès la moindre indication. Dès que tu seras rentrée nous allons travailler dur pour cela.
Pourquoi veux-tu appeler notre fille Heyliett ? Catherine est bien plus joli. Et nos dix filles ? Y avait Diane, y avait Line, y avait Marcelle et Martine. Ah ! Ah ! Catherinette, Catherina ! Y avait la belle Suzon ! Et la duchesse de Montbazon. Y avait Célimène. J’ai sous les yeux un calendrier plein de noms ravissants. Nous allons avoir 365 enfants. On en adoptera quelques uns. Tous avec un nom différent. Je me sens beaucoup plus paisible parmi les jeunes pousses. Ceux-là au moins ne connaîtront rien des vices de leurs pères. Laissez venir à moi les petits enfants. Si vous ne recevez ma parole comme un petit enfant…
Je t’adresse mes baisers d’après déjeuner et réserve le bas de la page pour ce soir. Tes fleurs me manquent beaucoup.
18 heures.
Mes baisers d’après dîner. Des Alsaciens chantent dans la cellule du dessous. Ils partent demain pour Épinal, enchaînés deux à deux et se réjouissent de retrouver leur camp en plein air. Fresnes devient de plus en plus chaud.
Les nouvelles, ce soir, sont des plus importantes et curieuses. Difficultés graves du gouvernement. Menaces en Grèce. Il semble que la tension augmente au point qu’il faille vite une solution. Ne nous impatientons point.
Tu veux bien toujours que je tienne ma promesse pour Noël ? À moins que tu aies changé d’avis. Fais-le moi savoir. Je prendrai mes dispositions en conséquence.
Ce soir je n’ai ni conte de fées, ni poèmes d’amour dans la tête. Pour toi, je ne te raconterai rien de littéraire, de romancé, de feuilletonesque, mais j’aimerai que tu sois là, que je puisse, de temps en temps, reposer ma tête sur ton épaule. Je regarderai ta broderie. Tu ne bougerais pas, et tu resterais à attendre que j’aie fini de dégorger tout le flot de paroles qui se pressent autour des tempes et qui demandent qu’on les chante. Alors, tard dans la nuit, je te montrerai les nouveaux enfants que j’aurais faits pour que le monde s’esclaffe, ou pleure, ou s’inquiète, ou s’énerve, ou prie. Des enfants à douze pattes, de la musique qui court dans la voix, avec des sanglots et des silences. Et seulement quand j’aurais dit tout ce que cette journée doit contenir, c’est-à-dire l’immense, l’incommensurable, le tout précieux, alors seulement je t’embrasserai et t’emmènerai sur le nuage où il fait bon dormir loin des hommes, loin de soi même, loin de la chair avide, loin du cœur méchant, tout près de la paix qui s’amuse toujours à rire jusqu’au petit matin. Je t’embrasse mille fois. Précisément mille.
J.
[1] En voulez-vous des z’homards : chanson populaire (scie) du début du siècle (Frédéric Muffat et Desmarets – Musique d’Émile Spencer), chantée notamment par Alfred Sulbac (1860-1927), décrit ainsi : une grosse tête, un large sourire permanent et, d’après les rares photos ou affiches qui nous sont parvenues, une attitude en scène qui devait, à la Devos, faire rire dès son entrée. Les scies qu’il débitait par la suite était sans importance sauf peut-être une : En voulez-vous des z’homards ? (note de FGR)
[2] Le ciron ou tyroglyphe de la farine est une espèce d’acarien d’une taille de 0,5 mm à 1 mm, donc un des rares (comme la tique) que l’on peut voir à l’œil nu. Pour Blaise Pascal, le ciron est le symbole de l’infiniment petit qu’il oppose au Cosmos, symbole de l’infiniment grand. (note de FGR)